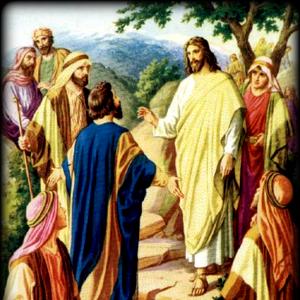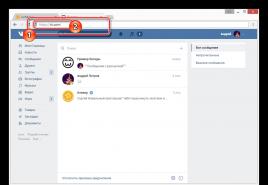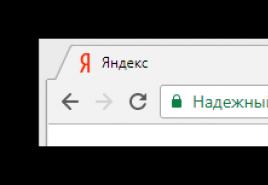Ce qui empêche les jeunes de se conformer à la religion. Débutez en sciences. Nouveaux croyants et vieilles églises
DOI : 10.12731/2218-7405-2016-7-232-263 UDC 316,74
LA RELIGION DANS LA PERCEPTION DE LA JEUNESSE MODERNE : CHIFFRES ET COMMENTAIRES
Savchenko I.A., Ustinkin S.V.
Cible. Étudier les indicateurs de religiosité / non-religion de la jeunesse russe moderne.
Méthodes de travail. Sur la base des documents de l'enquête sociologique "Repères religieux des étudiants modernes", l'attitude des jeunes de la Russie moderne vis-à-vis de la religion, de la foi et de l'athéisme est étudiée. Des méthodes qualitatives et quantitatives de collecte et d'analyse des résultats de recherche sont utilisées. Le travail a été réalisé en utilisant des méthodes scientifiques générales de cognition des phénomènes sociaux (analyse, analogie, comparaison, etc.) basées sur des dispositions et des conclusions méthodologiques dans lesquelles la dynamique ethno-confessionnelle est reconnue comme un processus intégral. Cette compréhension nécessitait une approche systématique.
Résultats. Des contradictions complexes se révèlent dans la perception qu'ont les jeunes des phénomènes religieux de la société moderne. Une attention particulière est portée aux positions évaluatives des étudiants par rapport à la religiosité, l'athéisme, le christianisme, l'islam et les autres religions.
Portée des résultats. Politique de jeunesse dans le domaine des relations ethno-confessionnelles. Les matériaux de l'article peuvent être utilisés dans le processus éducatif des établissements d'enseignement supérieur et secondaire dans le cadre de l'enseignement des sciences humaines. Dans le contexte des discussions sur la cléricalisation de l'éducation, les résultats de l'étude présentés dans l'article aideront à construire avec compétence des formations.
Mots clés : jeunesse ; la religion; religiosité; dénomination; ecclésiastiques; christianisme; Islam; athéisme; sécurité socioculturelle.
LA RELIGION DANS LA PERCEPTION DE LA JEUNESSE RUSSE : CHIFFRES ET COMMENTAIRES
Savchenko I.A., Ustinkin S.V.
Objectif. Rechercher des indices de religiosité/irréligion de la jeunesse russe moderne.
méthodologie. Sur la base d'un sondage sociologique "Points de référence religieux des étudiants modernes", la relation des jeunes de la Russie moderne avec la religion, la croyance et l'athéisme est étudiée. Des méthodes qualitatives et quantitatives de collecte et d'analyse des résultats de recherche sont utilisées. Le travail a été réalisé avec l'application des méthodes scientifiques générales de connaissance des phénomènes sociaux (analyse, analogie, comparaison, etc.) avec appui sur les dispositions méthodologiques et les conclusions reconnaissant la dynamique ethno confessionnelle comme processus complet. Une telle compréhension exigeait l'application d'une approche systémique.
résultats. De difficiles contradictions dans la perception qu'ont les jeunes des phénomènes religieux de la société moderne sont mises au jour. Une attention particulière est accordée aux positions critiques des étudiants concernant la religiosité, l'athéisme, le christianisme, l'islam et d'autres religions.
Les implications pratiques. Politique de jeunesse dans le domaine des relations ethno-religieuses.
Mots clés : sécurité socioculturelle ; la religion; piété; christianisme; Concession; prêtres; Islam.
Introduction
La situation socioculturelle actuelle, tant à l'échelle des pays qu'à l'échelle du monde, se caractérise par la multiplication d'événements et d'incidents "de couleur religieuse", et la religion, à son tour, devient non seulement spirituelle, mais aussi variable politique (ou politisée).
C'est pourquoi les attitudes religieuses de nos contemporains, en particulier des jeunes, deviennent aujourd'hui la variable la plus importante pour assurer la sécurité nationale de l'État.
stva. Dans ce contexte, l'étude des indicateurs de religiosité/non religiosité de la jeunesse russe moderne devient pertinente.
Recherche nationale et étrangère dans le cadre des problèmes identifiés
Dans la pratique nationale de la recherche sociologique, les études sur les orientations religieuses des citoyens russes, menées par le Centre analytique de Yuri Levada et le Centre panrusse de recherche sur l'opinion publique, sont bien connues.
En particulier, le centre analytique Yuri Levada étudie l'attitude des citoyens envers le patriarche, envers l'Église orthodoxe, les opinions des citoyens concernant le comportement du groupe Pussy Riot et la condamnation de ses membres, la perception publique de la relation entre l'Église et l'État , différenciation religieuse de genre.
Le Centre panrusse de recherche sur l'opinion publique a également obtenu des données assez intéressantes sur la transformation des orientations religieuses des citoyens russes par rapport au début des années 1990, sur le rôle de l'orthodoxie dans la société russe.
L'importance sociale, la qualité et l'exhaustivité des recherches menées par le VTsIOM et le Yu. Levada Analytical Center ne peuvent guère être surestimées. Mais il convient de noter que lors de la constitution d'échantillons de recherche représentatifs, le VTsIOM et le centre d'analyse Yuri Levada considèrent généralement l'ensemble de la société comme une population générale, tandis que pour nous, la population générale est constituée de jeunes qui étudient dans des établissements d'enseignement supérieur et secondaire.
Parmi les études domestiques qui abordent le problème des attitudes religieuses dans le milieu des jeunes, il faut distinguer l'étude des orientations religieuses des jeunes dans le contexte d'une société post-laïque, ainsi que le problème des stéréotypes dans le domaine de l'ethno -relations religieuses entre les jeunes. Il y a des œuvres où les problèmes de la foi en Dieu, dans l'au-delà, comme punition pendant la vie et après la mort
sont étudiés sur l'exemple des étudiants étrangers en comparaison avec les orientations des étudiants russes.
Parmi les ouvrages qui traitent de la relation entre religion et jeunesse, l'article de G.S. Shirokalova, OK Shimanskaya et A.V. Anikina, basée sur les matériaux d'une étude à grande échelle de la religiosité des étudiants sur l'exemple de la région de Nizhny Novgorod (2015). L'attention principale des auteurs est centrée sur les caractéristiques de genre de la religiosité des jeunes, cependant, l'article révèle également les caractéristiques générales de la religiosité des jeunes : l'auto-identification religieuse des élèves est déterminée, l'opinion des élèves sur le rôle de la religion dans la société. Certains aspects de l'article sont controversés. Par exemple, les auteurs, s'appuyant sur les résultats de l'enquête, analysent les raisons de la croissance de la religiosité en Russie, mais en même temps ne fournissent pas la preuve qu'une telle augmentation a réellement lieu. Malgré le fait que les auteurs se soient limités à utiliser des méthodes de recherche quantitatives, l'article contient des conclusions très précieuses, dont la plus profonde est que pour le jeune « atomisé » moderne, la fonction thérapeutique de la foi est passée au premier plan, ce qui ne devrait pas être le cas. être identifié avec une récompense compensatoire, orientée vers la récompense de l'au-delà ».
L'avantage incontestable de tous ces travaux est leur caractère empirique. Les méthodes de recherche quantitatives utilisées donnent une certaine coupe de la "réalité de l'opinion publique", cependant, une attention insuffisante au potentiel des méthodes qualitatives de recherche sociologique rend difficile la compréhension des causes et des implications de certaines opinions et fluctuations de la conscience religieuse des la jeunesse d'aujourd'hui.
Dans les sciences sociales étrangères, notamment britanniques et nord-américaines, la problématique « jeunesse et religion » de la dernière décennie est devenue l'objet d'une attention particulière des chercheurs. Ainsi, dans l'article de la sociologue britannique Sylvia Collins-Mayo « Youth and Religion : An International Perspective »
Nous présentons les résultats d'une étude sur le degré de religiosité des jeunes dans les pays d'Europe occidentale. La "croissance et l'importance sociologique de l'augmentation de la diversité religieuse chez les jeunes" sont montrées.
Collins-Mayo S. parle du « tournant subjectif de la culture post-moderne » (voir aussi I.S., S.W.]), qui génère une tendance à « l'individualisation et à la subjectivité » des jeunes Européens, en phase avec laquelle ils s'éloignent de plus en plus de non seulement les concepts de foi et de pratique, mais en général la religiosité et la spiritualité. En conséquence, comme le montre S. Collins-Mayo, la transmission des traditions religieuses d'une génération à l'autre devient de plus en plus difficile. La conscience religieuse, selon la juste affirmation de S. Collins-Mayo, en tant que phénomène d'ordre socioculturel, se forme dans une communauté et ne peut se développer et, qui plus est, se transmettre au niveau personnel. En dehors de la communauté religieuse, les vérités religieuses deviennent "relatives" (c'est-à-dire non absolues) et "non importantes" pour l'individu.
Le fait que seule "une minorité de jeunes dans la plupart des pays occidentaux vont à l'église" S. Collins-Mayo le définit comme un mauvais présage "pour l'avenir à long terme du christianisme". Par ailleurs, S. Collins-Mayo révèle la "prudence" dont font preuve les parents européens dans l'éducation religieuse de leurs enfants. L'auteur, en particulier, écrit que les parents en Angleterre s'abstiennent souvent de méthodes directives en matière de foi, préférant que leurs enfants fassent leur propre choix en matière de foi et de religion. S. Collins-Mayo constate avec regret que dans de telles conditions "beaucoup de jeunes grandissent avec peu de connaissance de la tradition de foi dont fait partie leur famille, et deviennent indifférents à la religion (ou à son absence) dans leur vie".
Un groupe de sociologues britanniques, les auteurs de l'article "Religion, Faith and Education" établissent la relation entre les croyances religieuses dans la famille et les méthodes éducatives utilisées par les parents vis-à-vis de leurs enfants. Les matériaux empiriques sont obtenus par les auteurs comme dans l'autochrone britannique
familles, d'une manière ou d'une autre, se référant à la tradition chrétienne, et dans les familles d'immigrés non chrétiens. Les auteurs arrivent à la conclusion que l'aspect religieux de l'éducation est extrêmement important et que son effet est positif lorsque ce facteur est utilisé de manière organique et compétente. Selon les mots des auteurs de l'article eux-mêmes, les conclusions qu'ils ont obtenues peuvent « remettre en question les hypothèses et les stéréotypes » et, en fin de compte, améliorer les résultats du processus éducatif dans la famille.
Les sociologues américains Melinda Denton, Lisa Pierce, Christian Smith, dans le rapport "Religion and Spirituality on the Way Through Youth", ont entrepris de décrire les modèles de changements religieux et spirituels parmi un échantillon national représentatif d'adolescents aux États-Unis de 2002 à 2005. sur les matériaux de leur étude, les aurors du rapport prédisent de fortes baisses de la religiosité des adolescents. En même temps, tout comme Sylvia Collins-Mayo, les auteurs du rapport établissent la tendance des jeunes interrogés qui se considèrent « croyants, mais pas religieux » à différencier religion et foi, ce qui complique finalement la vie et la vie spirituelle de ceux qui tracent le « chemin de la jeunesse ».
B. Pope, J. Price, D.R. Lillard dans son article "L'impact de la religion sur le comportement des jeunes" évalue la relation entre la fréquentation de l'église et la délinquance juvénile et arrive à la conclusion importante que les jeunes qui fréquentent l'église assez souvent sont moins susceptibles de devenir toxicomanes, délinquants et criminels. Ainsi, B. Pope, J. Price et D.R. Lillard démystifie le mythe moderne, populaire dans les pays occidentaux, selon lequel la conscience religieuse n'affecte pas la relation de l'individu avec la loi.
L. Lippman et G. McIntosh, les auteurs de l'article "La démographie de la spiritualité et de la religiosité chez les jeunes aux États-Unis et dans d'autres pays", relient le développement du marché et des technologies au déclin du rôle social des religions traditionnelles valeurs. Les auteurs sont sûrs que la spiritualité « ne va pas de pair avec la religiosité ».
Ainsi, la recherche étrangère sur les sujets désignés est assez vaste et multiforme. En attendant, ils manquent certainement de profondeur et de détail, ce qui s'explique, encore une fois, par un manque d'attention au potentiel des méthodes qualitatives de collecte et d'analyse des informations sociologiques reçues, à la suite desquelles une esquisse de la réalité sociale est créée sans possibilité comprendre les causes des faits et des opinions.
L'actualisation sociale des problèmes de dynamiques ethno-confessionnelles dans le milieu des jeunes et, parallèlement, le niveau insuffisant de leur étude scientifique, ont déterminé le choix du sujet de cet article.
Formulation du problème
La première tâche instrumentale de l'étude consiste à combiner l'analyse quantitative et l'analyse qualitative dans le processus de collecte et d'analyse des faits sociaux, ce qui, à son tour, fournit une solution à la deuxième tâche principale : comprendre la cause et les motifs des opinions. et les appréciations propres aux jeunes par rapport à divers phénomènes de nature religieuse.
Base empirique et méthodologie de recherche
Pour étudier l'attitude de la jeunesse étudiante moderne à l'égard de la religion, des mouvements religieux, de l'église et pour déterminer les tendances principales et possibles dans le développement de la conscience de soi religieuse / contre-religieuse des jeunes, une enquête par questionnaire "Repères religieux des étudiants modernes" a été menée . La réponse à chaque question du questionnaire devait être accompagnée d'un commentaire : « Pourquoi ? », « Pour quelle raison ? », « Quelle est votre attitude face à ce fait ».
Dans les commentaires, nous avons volontairement conservé le style et le vocabulaire, en corrigeant uniquement les fautes d'orthographe et de ponctuation.
L'enquête a été menée du 28 septembre 2015 au 27 mai 2016 sur un échantillon représentatif (étudiants et étudiantes) parmi les étudiants de la deuxième - quatrième année des universités, leurs filières
et Suzov de Nizhny Novgorod et la région de Nizhny Novgorod (Arzamas, Vacha, Kstovo, Perevoz, Vyksa, Zavolzhye, Dzerzhinsk, Bogorodsk, Bor). Le nombre total de répondants - 947 personnes; âge : de 18 à 23 ans. L'erreur statistique des données n'est pas supérieure à 4,7%.
L'étude a été menée dans des salles de classe par des enseignants d'établissements d'enseignement supérieur et secondaire de ces villes. Nous remercions nos collègues pour leur aide dans la réalisation de la recherche.
Résultats de recherche
Dans la première question, nous avons demandé si les élèves se considéraient religieux. Réponses à la question "Êtes-vous une personne religieuse?" présenté dans le schéma 1.
100 VO 60 40 20 O
Schéma 1. Le degré de religiosité des jeunes
Nous voyons qu'une écrasante minorité (6%) se considère comme des personnes religieuses. Et même ces 6% avouent leur religiosité avec réserve, avec un œil sur leur entourage. Voici un commentaire « Oui » typique : « Relativement religieux. Je vais à l'église, mais assez rarement » (fille, 20 ans).
Êtes-vous une personne religieuse?
Oui Non Pas vraiment
religieux
Pour la première fois dans notre étude, les étudiants qui se considèrent « peu religieux », et 9 % d'entre eux, pointent souvent et clairement la différence entre église et religion (dont nous parlerons plus bas) : « Je suis plutôt croyant , moins religieux » (un jeune homme, 21 ans).
Les motivations de ceux qui ne se considèrent définitivement pas religieux sont intéressantes et variées. Le commentaire le plus courant est : « Absolument pas religieux. Il semble que nos répondants aiment le mot « absolument ». Les gens veulent être absolus dans quelque chose. Bien sûr, nous voyons ici des signes de narcissisme caché.
Parfois, s'admirer ressemble à un jeu de repentir : « Je ne peux pas me dire religieux. Je fais beaucoup d'erreurs." Ce « pécheur » était un jeune homme de 19 ans.
La soi-disant « auto-évaluation sobre » et même l'autocritique sont assez courantes :
Jeune homme, 20 ans : Je ne me considère pas comme une personne religieuse, car je ne jeûne pas, je vais très rarement à l'église, je ne connais pas une seule prière par cœur.
Fille, 20 ans : « Je ne suis pas une personne religieuse. Je ne vois pas l'intérêt de cela. Mais je vais à l'église pour communier avec ma grand-mère chaque année. J'avais l'habitude d'y aller, je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, je ne peux aller que comparer les sensations et mon état, car un pouvoir presque magique est attribué au sacrement.
Fille, 22 ans : Je ne suis pas une personne religieuse. Je pense que la religiosité implique cohérence et constance. Par exemple, aller à l'église, connaître les prières. Je ne connais pas une seule prière et je vais rarement à l'église.
Certains répondants soulignent que la religiosité est inculquée dès l'enfance : « Je ne peux pas me dire religieux. Je pense que ça se passe dans la petite enfance, et il n'y a pas de religieux dans ma famille » (garçon, 21 ans).
Assez rarement, l'incroyance s'explique par le doute, la recherche spirituelle : « Je ne suis pas religieux, car je ne sais pas s'il y a un Dieu » (jeune homme, 19 ans).
D'autres manifestent leur non-religion comme résistance à la manipulation : « Non, parce que je crois que c'est une façon de contrôler la conscience de masse » (jeune homme, 21 ans).
Enfin, certains font la distinction entre religiosité et intérêt scientifique pour la religion : « Je ne me considère pas comme une personne religieuse, mais je tire activement des informations de diverses sources liées à la religion pour mon développement intellectuel. J'ai lu la Bible (Ancien Testament) comme un conte de fées juif intéressant, plein d'allégories et d'emprunts à l'épopée et à la mythologie sumériennes » (jeune homme, 20 ans).
Les réponses à la première question montrent que non seulement les élèves ne se considèrent pas religieux, mais qu'ils ne veulent pas l'être. Les jeunes sont convaincus que la religiosité est quelque chose de démodé et même pas prestigieux. Certains manifestent une protestation contre la religion. Pourtant, les propos des étudiants témoignent d'une recherche intérieure, d'une lutte de motivations. Tout en se déclarant non religieux, les étudiants sont en même temps dans un état de recherche, de doutes et de lutte morale interne.
« Quelle est votre attitude envers les personnes religieuses (croyantes) ? » - c'est ainsi que la troisième question de notre questionnaire a été formulée. Les réponses des élèves sont présentées dans le diagramme 2.
Diagramme 2. Attitude des élèves envers les personnes religieuses et croyantes
Comme on peut le voir, la moitié des étudiants sont indifférents aux religieux, 35% sont contradictoires, le reste est soit fortement négatif (6%) soit positif - 9%.
Les commentaires de ceux qui manifestent de la sympathie pour les religieux se sont révélés extrêmement avares et peu variés : « très positif », « je les traite (très) (même) bien », etc. Une telle attitude positive a été démontrée soit par les étudiants qui reconnaissaient leur religiosité, et tels, rappelons-le, 6%, soit par ceux qui démontrent constamment leur tolérance, leur exactitude et d'autres qualités similaires de question en question.
Le nombre d'étudiants qui ont une attitude fortement négative envers les personnes religieuses est faible. Ils expliquent leur position, en règle générale, avec la peur et même l'horreur que peuvent provoquer les personnes pieuses : « Les personnes trop pieuses me font peur, car sous l'influence de la foi, elles peuvent tout faire » (fille, 20 ans).
Un assez grand nombre d'étudiants ont une attitude « contradictoire » envers les religieux. Les attitudes contradictoires envers les religieux s'expliquent le plus souvent par l'opposition entre « vrais croyants » et fanatiques :
Jeune homme, 20 ans. Je traite toutes les personnes avec respect. Je traite bien les vrais croyants, car il est très difficile de suivre les canons de l'église. Mais j'ai une attitude négative envers les fanatiques.
De la même manière, une appréciation contradictoire s'accompagne souvent d'un contraste entre « simples croyants » et fanatiques :
Jeune homme, 20 ans. Je ne comprends pas les fanatiques et les débatteurs avec la science, avec des faits avérés. Beaucoup que je considère stupides et étroits d'esprit.
Fille, 21 ans. L'attitude serait neutre sinon pour les fanatiques - j'ai peur d'eux.
Les plus souvent opposés sont « croyants calmes » et « imposer leur foi ».
Fille, 18 ans. Il y a des gens qui sont croyants, mais n'imposent leurs croyances à personne et ne méprisent pas les autres
personnes (incroyantes). J'ai des amis religieux et j'apprécie ces relations, car de tels amis ne sont pas contre mes opinions. Et je ne supporte pas les gens qui défendent avec zèle la religion et les forcent à y adhérer, et c'est désagréable pour moi d'être près d'eux.
Jeune homme, 22 ans. S'ils n'imposent pas leur religion, ne se considèrent pas supérieurs aux autres, alors, en principe, on pourrait les traiter positivement.
La majorité des étudiants qui sont "indifférents" aux personnes religieuses. Ils expliquent leur position comme suit.
Jeune, 21 ans. Je suis neutre envers les personnes religieuses. Ils existent, ils n'existent pas, je m'en fous.
Fille, 20 ans. C'est leur choix, leur chemin.
Jeune, 19 ans. Je ne fais pas attention à eux.
Fille, 19 ans. Si seulement cela ne me concernait pas personnellement et qu'il ne se produisait pas quelque chose d'inadapté.
Jeune homme, 20 ans. Si vous voulez croire en Dieu, jeûnez, allez à l'église - croyez, jeûnez, allez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Fille, 20 ans. L'essentiel est de ne rien imposer.
Il faut bien admettre que l'indifférence démonstrative de la plupart des répondants à l'égard des religieux s'apparente dans un certain nombre de cas à de la négligence. Traiter « les autres » comme des lépreux n'est pas une très bonne caractéristique des jeunes. Nous avons eu l'impression que les élèves aimaient parler de l'indifférence envers les religieux. En effet, il n'y a pas tant de personnes et de catégories de personnes auxquelles on peut se permettre d'être indifférent. Un élève, même contre son gré, ne peut être indifférent à ses parents, à ses professeurs, à ceux qui sont au pouvoir. C'était peut-être réconfortant pour les élèves de savoir qu'il y avait des gens autour desquels ils pouvaient rester indifférents.
Les réponses aux questions précédentes ont naturellement suggéré de nouvelles questions afin de concrétiser les problèmes et les contradictions identifiés. Par conséquent, les réponses à la quatrième question « Séparez-vous l'église et la religion pour vous-même ? étaient particulièrement importants pour nous (schéma 3).
Séparez-vous l'église et la religion pour vous-même ?
Oui Non Partiellement
partager
Diagramme 3. Corrélation entre la religion et l'église telle qu'elle est comprise par les élèves
Dans le contexte des réponses précédentes, les données sur la relation entre la religion et l'église dans la compréhension des étudiants ont quelque peu surpris. Jusqu'à présent, il était évident que les étudiants associaient Dieu au Christ, et la religiosité - à l'adhésion à la foi orthodoxe (et à aucune autre), mais en même temps, 56% séparent clairement la religion de l'église, 9% se séparent partiellement, et seulement 35% ne se séparent pas. Dans l'ensemble, les étudiants ont été surpris par ce problème, ils ont soudainement découvert un nouveau motif d'indignation - l'église, en comparaison de laquelle la religion et la religiosité semblent moins odieuses.
D'une manière ou d'une autre, la question n'a pas laissé les répondants indifférents. Voici ce que disent les étudiants qui séparent le concept de religion de celui d'église.
Fille, 21 ans. Je partage, parce que l'église a une énorme somme d'argent provenant de la vente d'ustensiles d'église.
Jeune homme, 20 ans. je distingue. Vous pouvez être une personne profondément religieuse et ne pas payer des étrangers pour des « services divins ».
Fille, 21 ans. En Russie, la religion et l'église sont deux choses différentes. Le ROC tourne autour de l'argent et du prestige. Il n'y a pratiquement pas de 244 -
il y avait un lien avec la religion (peut-être pas partout). Il y a de petites églises et des monastères où vivent des religieux. Ce ne sont pas des fanatiques, mais des gens ordinaires et instruits. Ils peuvent facilement raconter une histoire, aider avec des conseils. Ils n'accepteront pas de cadeaux coûteux.
Jeune homme, 20 ans. Pour croire en quelqu'un, il n'est pas nécessaire d'aller à l'église chaque semaine et de jeûner.
Fille, 22 ans. L'église a été créée dans un but de contrôle, agit comme un pouvoir supplémentaire.
Fille, 20 ans. Je distingue, parce que tous les croyants, autant que je sache, ne vont pas à l'église, et l'église à travers l'histoire s'est trop permise.
Pour certains, l'église n'est qu'un bâtiment, une pièce :
Jeune, 21 ans. Dans ma compréhension, la religion est une science. L'église est un bâtiment inutile.
Fille, 19 ans. La religion est ce en quoi une personne croit et croit, et l'église n'est qu'un intermédiaire, un lieu où une personne peut être seule avec elle-même et Dieu.
Fille, 21 ans. La religion est une certaine idéologie, une tendance qui englobe un grand nombre de personnes qui croient en Dieu. Une église est un temple religieux, un lieu de culte pour les gens devant Dieu.
Il y a des déclarations choquantes : « Je partage. La foi doit être autre chose, pas la masse. Prier pour le spectacle, c'est comme lire la Bible de Lucifer au Purgatoire » (jeune homme, 20 ans).
Seule une infime partie de ceux qui séparent l'Église de la religion préfèrent l'Église à la religion. En même temps, l'église est à nouveau comprise comme un temple, une maison :
Fille, 19 ans. L'église est un endroit où vous pouvez sentir Dieu. La religion est un outil pour contrôler les gens.
Les répondants qui ont déclaré que « non, ils ne séparent pas » l'Église et la religion écrivent très souvent : « L'Église fait partie de la religion ». La réponse n'est pas rare : "Pour moi, l'église c'est la religion." Il y a aussi des réponses comme celle-ci : « À mon avis, l'Église et la religion sont inséparables. L'Église est un médiateur entre la religion et les croyants » (fille, 20 ans).
À notre avis, les étudiants qui ne séparent pas l'Église de la religion expriment une certaine position, une opinion, qu'ils sont, en principe, prêts à défendre. Une telle position donne l'impression, sinon tout à fait correcte du point de vue de la science, mais plus ou moins mature et réfléchie, contrairement à la position de ceux qui "séparent", mais expliquent leur opinion de la manière la plus étrange.
D'une manière ou d'une autre, répondant à la question sur les problèmes de différenciation entre religion et église, les étudiants, hélas, ne se sont pas révélés être des gens lettrés et érudits. Seuls parmi ceux qui « partagent partiellement » (et on rappelle qu'ils ne sont que 9 %) se trouvent des affirmations plus ou moins proches de la position de la science moderne : « La religion peut exister séparément de l'Église. Il n'y a pas d'église sans religion » (jeune homme, 20 ans).
Aucun des répondants ne savait simplement que l'église est un concept spécifique pour le christianisme, et non pour aucune autre religion. Jusqu'à présent, en répondant à nos questions, les étudiants ne se sont jamais souvenus qu'il y a pas mal d'autres religions dans le monde en plus de la religion chrétienne.
La quatrième question est « Quelle est votre attitude envers le christianisme ? C'était une question à laquelle les étudiants, qui dans leur grande majorité ne séparent pas le christianisme de la religion et le christianisme de l'église, ont déjà répondu d'une manière ou d'une autre, bien qu'ils ne s'en soient peut-être pas rendu compte. Pendant ce temps, les réponses à cette question nous ont ouvert quelque chose de nouveau. Ce n'est pas surprenant, car cette question fait pour la première fois référence d'une manière ou d'une autre à ce qu'il y a dans le monde de la religion et d'ailleurs dans le monde chrétien. Il est assez important (on le verra dans le commentaire) qu'après avoir lu la question sur le christianisme, les élèves aient réfléchi à l'existence des confessions chrétiennes (orthodoxie, catholicisme, protestantisme), se soient souvenus qu'il y a l'islam et même les sectes. Dans ce cas, nous pouvons dire, non sans satisfaction intérieure, que l'enquête a eu une valeur éducative et développementale, agissant comme une méthode pédagogique active. Les réponses à la question sur les attitudes des élèves envers le christianisme sont présentées dans le diagramme 4.
Quelle est votre attitude envers le christianisme ?
Positif Négatif Controversé Respectueux, Indifférent
Schéma 4. Attitude des étudiants envers le christianisme
Nous avons découvert que la majorité des répondants ont une assez bonne attitude envers le christianisme : 18% - "positivement", 41% - respectueusement. Le nombre de ceux qui traitent le christianisme "avec indifférence" est également assez important - 21%. Un petit nombre d'étudiants - 7% - ont une attitude négative envers le christianisme, 13% ont des sentiments contradictoires.
Commençons par le fait que les répondants expliquent leur attitude "négative" envers le christianisme à peu près de la même manière : "tromperie des gens", "stupéfaction de l'esprit", "propagande", "phénomène non scientifique", etc.
Les répondants expliquent l'attitude « positive » envers le christianisme, principalement par le lien avec la tradition, la culture russe, ou avec la nature relativement libérale de la religion, par rapport aux autres :
Fille, 19 ans. C'est la religion de ma culture.
Fille, 21 ans. Comparé à l'islam, il n'y a pas tellement d'interdictions dans le christianisme (par exemple, ne pas manger de porc), donc je suis content d'appartenir au christianisme.
Jeune, 21 ans. Je suis une personne orthodoxe, je suis fidèle à d'autres domaines du christianisme. Aux sectes - négativement.
Les étudiants qui traitent le christianisme avec rien de plus que du respect » s'efforcent de faire preuve d'exactitude, d'acceptation et de compréhension. Ils ne sont "pas contre" le christianisme.
Fille, 20 ans. Je respecte toutes les religions du monde, y compris le christianisme.
Jeune, 21 ans. Je respecte toute la tendance - catholicisme, protestantisme, orthodoxie.
Fille, 19 ans. Je crois que les gens ont le droit de choisir la religion qui leur est préférable.
Jeune homme, 22 ans. Je respecte toutes les dénominations chrétiennes traditionnelles, car ce sont des concepts historiques. Tout le reste, je le considère comme des sectes. J'ai une attitude négative envers les sectes, car dans une secte, elles bouleversent complètement la conscience d'une personne et font des choses terribles.
Parfois, dans une « attitude respectueuse », des appréciations critiques du christianisme se glissent : « Pour moi, toutes les confessions se valent. Mais le christianisme, à mon avis, n'est pas une religion aussi forte que, par exemple, l'islam ou le bouddhisme » (garçon, 20 ans).
Certains commentaires sont intéressants, mais inattendus et, sans explications supplémentaires, incompréhensibles : « Mon grand-père a été baptisé quand il est venu en URSS » (jeune homme, 21 ans).
L'attitude « instable, contradictoire » à l'égard du christianisme est expliquée par les étudiants de manière plutôt retenue et avec peu d'émotion.
Jeune, 21 ans. Il y a des désaccords avec les dogmes chrétiens, mais sans négativité.
Fille, 20 ans. Ce phénomène ne me cause que de l'intérêt et uniquement. Intéressant comme science, histoire. Ces phénomènes ne provoquent pas d'autres sentiments et émotions.
Fille, 21 ans. Intéressé uniquement par l'histoire.
Fille, 10 ans. Les gens font leurs propres choix dans leur vie. Quant aux sectes, elles n'ont le droit d'exister que si elles ne nuisent pas à la société.
Jeune, 19 ans. Je suis calme à propos de l'orthodoxie. Je considère le protestantisme comme une dénomination prudente. On sait peu de choses sur les autres concessions.
Les étudiants expliquent souvent leur attitude indifférente envers le christianisme par une non-religion générale : « L'attitude envers le christianisme est la même qu'envers la religion en général, à savoir l'indifférence.
Parfois derrière « l'indifférence », on peut voir une position plutôt ferme : « J'ai une attitude neutre vis-à-vis du christianisme. J'ai une attitude négative envers les sectes et le protestantisme » (jeune homme, 20 ans).
De par la nature des réponses à la question sur les attitudes à l'égard du christianisme, il est devenu clair que les «signaux d'arrêt» archétypaux inconscients ne permettent pas à de nombreux étudiants «à la volée» de connoter négativement le concept de christianisme. Quelque chose au niveau de l'inconscient collectif les en empêche. Une attitude respectueuse envers la religion chrétienne en tant que composante la plus importante du destin historique du peuple russe est caractéristique de la majorité absolue des répondants. Dans l'ensemble, la différence dans les réponses réside dans la mesure dans laquelle une telle attitude est reconnue et démontrée.
La question 7 était formulée comme suit : « Quelle est votre attitude envers le clergé » (Schéma 5). 28% des étudiants ont une attitude positive envers le clergé, le même nombre est indifférent, seulement 6% sont négatifs et 38% sont contradictoires.
Schéma 5. Attitude des étudiants envers le clergé
Les étudiants commentent l'attitude positive envers le clergé quelque chose comme ceci : « Je les traite très bien », « Je les respecte », etc.
Il y a peu d'attitudes "négatives" envers les ecclésiastiques. Soit les étudiants n'expliquent pas cette position, soit ils disent que les prêtres ne sont « pas des messagers de Dieu sur terre, mais des gens ordinaires », « ils pensent trop à eux-mêmes », « ils ont perdu leur conscience ».
Jeune homme, 20 ans. Pour certains membres du clergé, vous ne pouvez pas dire qu'ils mènent une vie ascétique. Encore une fois - des hommes d'affaires à leur manière.
Fille, 20 ans. D'une part, ils (les prêtres) servent Dieu et aident les gens. D'autre part, ils portent des montres en or et conduisent des voitures très chères.
Jeune homme, 20 ans. J'ai une bonne attitude envers le clergé qui suit tous les canons et répond à toutes les exigences. Si le prêtre lui-même abuse de sa position, alors mon attitude est fortement négative.
Jeune, 21 ans. Double relation. Le médiateur entre le mental supérieur et les gens doit renoncer aux biens matériels. Et cela est objectivement nuisible.
L'attitude indifférente envers le clergé est commentée de manière assez monotone : "Absolument indifférent à leur égard", "Je ne leur prête pas attention", "Si seulement ils ne m'imposaient rien personnellement".
La question de l'attitude envers le clergé révèle une importante contradiction. En essayant de déterminer leur attitude envers le clergé, les étudiants éprouvent une dissonance cognitive. D'une part, les répondants représentent des « pères » bien particuliers qu'ils ont vus personnellement, avec qui ils communiquaient lorsqu'ils venaient à l'église. Et l'attitude envers ces ministres
culte - presque toujours positif. D'autre part, il existe une idée collective abstraite du clergé, entourée de rumeurs sur la richesse imaginaire du clergé et d'informations médiatiques non vérifiées. Ici, une autre caractéristique importante de la perception des étudiants des questions liées à la religion a été révélée. Par « prêtres », les étudiants n'entendent que les ministres du culte orthodoxe, ils ne soulèvent pas pour eux-mêmes la question des ministres d'une religion différente.
Ayant compris les orientations religieuses et de valeurs des étudiants dans le cadre de la religion chrétienne, nous ne pouvions pas ignorer la question de l'islam. La situation générale dans le monde oblige à se demander : « Quelle est votre attitude envers l'Islam ? (Schéma 6).
Seuls 6% ont une attitude positive envers l'islam, le même nombre (11%) - « calmement » et « indifféremment » ; 39 % - contradictoires et 33 % - négatifs. A vrai dire, nous nous attendions à des résultats quelque peu différents, plus « équilibrés », et les commentaires reçus des étudiants dans cette veine sont particulièrement significatifs.
Quelle est votre attitude vis-à-vis de l'Islam ?
Positif Négatif Calme Contradictoire Indifférent
Schéma 6. Attitude des étudiants envers l'islam
Les élèves qui avaient une attitude positive vis-à-vis de l'islam étaient laconiques : « Je ne suis pas musulman, mais ma grand-mère est musulmane », « Je suis mu- 251 -
Sulman" (se référant évidemment à 4 % des non-baptisés). Il y a aussi des commentaires plus longs qui soulignent les avantages de l'islam, en particulier, sur l'orthodoxie : « Cette religion diffère de l'orthodoxie par une certaine rigueur et un certain rituel, ce qui rend l'islam unique, irremplaçable » (fille, 20 ans). "L'islam aspire au "socialisme" sur la base de la religion" (un jeune homme de 20 ans) - de telles déclarations témoignent de l'érudition générale du répondant.
Une attitude « calme » envers l'islam témoigne d'une position tolérante dans l'esprit du multiconfessionnalisme : « je traite l'islam comme je traite toutes les religions », « je traite l'islam calmement, comme je traite toutes les autres religions ».
La connotation "négative" de l'Islam mérite une attention particulière. Premièrement, il y a une attitude négative envers certains musulmans que nos répondants ont dû rencontrer :
Fille, 19 ans. Je n'aime pas les gens de confession islamique. Fille, 21 ans. L'attitude envers l'islam devient de plus en plus négative, car il y a agression de la part des personnes qui professent l'islam.
Deuxièmement, il y a une attitude négative envers les canons spécifiques de l'Islam :
Fille, 20 ans. L'islam est une religion agressive aux fondements terribles. Je le prends très négativement.
Troisièmement, en ce qui concerne l'islam, des phénomènes tels que l'intégrisme islamique et le terrorisme affectent :
Jeune, 21 ans. A ce jour, la tradition de l'Islam est en train de disparaître dans sa forme originelle, cette religion devient radicale et négative envers les autres religions.
Fille, 21 ans. Il y a de la peur. En lien avec les derniers événements dans le monde.
Enfin, certains avis sont polymotivés : Fille, 20 ans. Surtout à l'étape actuelle, l'Islam provoque la peur : traditions cruelles plus terrorisme, et j'ai toujours essayé d'une manière ou d'une autre d'éviter les gens de cette religion.
Jeune homme, 20 ans. Une autre culture, parfois en conflit avec la tradition russe (chrétienne). Comme le montre l'histoire, ces conflits ont plus d'une fois provoqué des hostilités et des pertes humaines massives.
Les répondants tentent d'étayer l'attitude « controversée » envers l'islam par des arguments : mettre en évidence les aspects positifs et négatifs de la religion musulmane.
Jeune, 21 ans. Une religion très puissante. Fort. Seul l'islam ne reconnaît pas les autres religions. C'est un moins. Je pense qu'en Russie, l'islam se développe de façon exponentielle, ainsi que dans le monde entier.
Fille, 20 ans. Je traite l'islam comme toutes les religions. Mais l'islamisation dans le monde moderne est très grave. Après tout, de nombreuses organisations islamistes recrutent des gens.
Fille, 20 ans. J'ai une attitude positive envers l'islam en général. À ses représentants radicaux - négativement. Rien ne peut influencer une idée plus négativement que ses représentants radicaux.
Certains répondants « controversés » à propos de l'islam tentent (pas toujours habilement) d'apporter quelques éclaircissements sur la question en discussion :
Jeune homme, 20 ans. Le problème n'est pas dans l'Islam, mais dans la religion, dans le désir de la suprématie de son propre Dieu sur les autres.
Fille, 20 ans. L'Islam est neutre. Il me semble qu'à cause des terroristes, une attitude fortement négative s'est développée envers cette religion, mais je crois qu'il est impossible de haïr tout le monde uniquement à cause des terroristes, car il y a beaucoup de gens pacifiques et gentils parmi les adeptes de l'islam.
Fille, 21 ans. Je crois que l'islam est un prétexte pour continuer la politique. Il me semble que les musulmans islamistes, adhérents de l'ISIS, pensent plus à conquérir le monde qu'à promouvoir leur religion dans d'autres pays. Sous prétexte qu'ils donnent libre cours à leur sadisme, n'excluant pas qu'ils recrutent des musulmans pacifiques (rappelant le recrutement pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'Allemagne nazie - une analogie purement facile).
Ceux qui sont "calmes" vis-à-vis de l'Islam sont laconiques : "L'attitude est calme - comme pour toutes les religions" "Je n'ai rien contre la foi (je m'intéresse à l'histoire des religions)".
De toute évidence, l'attitude des étudiants envers l'islam est ambivalente. D'une part, les jeunes s'efforcent d'être corrects, tolérants, respectueux des autres cultures et religions. En revanche, certains rituels de l'islam radical et, en général, le halo de danger qui est devenu récemment caractéristique de tout ce qui touche à cette religion, déroute nombre de nos interlocuteurs. Ils aimeraient dire quelque chose de positif à son sujet, mais ils ne savent pas exactement quoi : « C'est très difficile à dire sur mon attitude envers l'islam. Les médias regorgent désormais de gros titres bruyants sur le terrorisme. Je ne sais pas » (fille, 20 ans). Il ne fait aucun doute que toutes les questions liées à l'islam, aux attitudes à son égard, à son rôle dans la dynamique sociale des sociétés modernes doivent être abordées dans un contexte interdisciplinaire et multiforme, basé sur les principes d'une approche systématique.
Diagramme 7. Attitude des étudiants envers les autres mouvements religieux non chrétiens (en dehors de l'islam) (bouddhisme, judaïsme, hindouisme (y compris Hare Krishnas et bouddhistes zen), etc.)
Nous avons également interrogé les étudiants sur leurs attitudes envers les autres religions (en dehors de l'Islam et du Christianisme). D'où - question 7 "Ka-254 -
Quelle est votre attitude envers les autres mouvements religieux non chrétiens (bouddhisme, judaïsme, hindouisme (y compris Hare Krishnas et bouddhistes zen), etc.) ? » (Schéma 12) : 28 % des répondants ont une attitude positive envers ces religions, 5 % - négativement ; 24% - calmement, 8% - contradictoires et 35% - indifférents.
Voici comment les élèves commentent l'attitude positive envers ces religions :
Fille, 20 ans. J'aime beaucoup le bouddhisme et le bouddhisme zen car ce sont des religions d'acceptation, d'amour et de gratitude. Cela a ses inconvénients, mais dans le bouddhisme, rien ne fait souffrir les gens.
Fille, 22 ans. Une attitude positive, puisque ces religions sont fondées sur la paix, la tranquillité d'esprit, et non sur le pouvoir. Ils visent à rendre une personne plus heureuse (moralement) et ne la limitent pas.
Jeune, 19 ans. Positif, surtout envers le bouddhisme et le judaïsme.
L'attitude « négative » dans ce cas est basée sur l'association avec les sectes : « Ces mouvements religieux ressemblent plus à des sectes » (garçon de 20 ans), « Je ne fais pas confiance aux gens en vêtements blancs » (21 ans garçon).
Pour beaucoup, les mouvements religieux discutés font craindre l'incompréhensible. Cependant, les répondants comprennent qu'il est impossible de condamner aveuglément l'incompréhensible - d'où l'attitude «contradictoire»: «Ces religions sont complètement incompréhensibles pour nous», «Cela ne me dérangerait pas si ces religions ne cherchaient pas à éloigner une personne de la réalité », « Quelque chose de très étrange ».
"Tranquillement" liés aux "autres religions non chrétiennes", ils disent qu'ils "ont juste un intérêt pour les mouvements religieux non chrétiens", "J'aime lire sur d'autres mouvements. C'est très intéressant », « je respecte les représentants de toutes les confessions ».
Ceux qui appartiennent aux religions indiquées sont "indifférents", et ces étudiants sont les plus nombreux, dans les commentaires sont retenus. Les répondants ici admettent objectivement qu'ils ne sont "pas très compétents en la matière" et donc "absolument indifférents", "ne s'y rapportent pas du tout", "absolument s'en fichent".
La principale conclusion basée sur les résultats des réponses à la question sur les « autres » religions est que ces religions suscitent beaucoup moins d'émotions chez les répondants que le christianisme et l'islam. Ces religions sont peu connues des étudiants. Ces idées sur le bouddhisme, le judaïsme, l'hindouisme, etc., qu'ils ont encore, sont extrêmement superficielles et superficielles. Dans ce cas, les étudiants manquent clairement d'érudition et d'éducation.
En discutant des réponses des répondants, nous sommes tombés sur un phénomène tel que l'athéisme des jeunes protestataires. La huitième question était formulée comme suit : « Que pensez-vous de l'athéisme des jeunes protestataires ? Il s'est avéré que la grande majorité des étudiants ne se rendaient pas compte qu'ils parlaient d'eux-mêmes, que c'était d'eux que venait la protestation contre l'athéisme des jeunes. Seuls 13% ont une attitude positive envers ce phénomène, 32% - fortement négativement, 15% - comme un signal d'alarme, 30% - avec compréhension, 10% - indifféremment.
Diagramme 9. Attitude des étudiants envers l'athéisme des jeunes protestataires
Les attitudes « positives » envers les athées protestataires sympathisent avec eux en tant que « personnes libres avec leur propre position » :
Jeune homme de 20 ans. C'est le droit de chacun d'être athée ou non, mais en URSS c'était la norme, et ils ont essayé d'éradiquer la religiosité. Jeune homme de 20 ans. C'est le signe d'un esprit sain.
Fille, 10 ans. Comportement correct dans les circonstances.
L'attitude "négative" envers les jeunes athées est commentée émotionnellement et de manière critique (mais pas autocritique) par les étudiants :
Fille de 20 ans. Je ne pense pas que les jeunes puissent évaluer correctement l'athéisme et je suis sûr que beaucoup de jeunes nient la religion simplement par ignorance.
Jeune homme de 20 ans. J'ai une attitude plutôt négative envers l'athéisme protestataire des jeunes - j'en ai marre.
Fille de 21 ans. Je le prends négativement. Les gens, sans comprendre, ne font que suivre la mode, et c'est stupide.
Fille de 19 ans. J'ai une attitude très négative envers l'athéisme des jeunes. C'est à la mode maintenant, et la plupart des jeunes ne peuvent même pas expliquer ce qu'est Dieu. Mais ils ne croient plus en lui et crient à chaque pas.
Jeune homme de 20 ans. Très négatif. Pour moi, c'est de la posture. Je me souviens immédiatement du dialogue de Woland avec Berlioz. Trop de refus. Le cynisme juvénile se retourne contre lui. En fait, être athée maintenant, c'est comme retrousser son pantalon et les femmes voulant acheter des Louboutins et des pantalons incroyables.
Le jeune homme a 21 ans. L'athéisme de protestation est dû à la stupidité et à l'ignorance des gens de la différence entre la religion et l'Église orthodoxe russe.
Fille de 20 ans. J'ai la même attitude que n'importe quel autre mouvement de jeunesse - négativement. Les gens, les enfants ne pensent pas, mais captent des idées déformées.
Les personnes interrogées qui traitent l'athéisme des jeunes protestataires « avec compréhension » semblent mépriser leurs pairs :
Fille de 21 ans. Les jeunes, pour la plupart, sont maximalistes. Je crois qu'ils renient Dieu à cause de notre ROC. Si l'approche de l'église était différente, alors l'attitude envers Dieu changerait. Je crois qu'avec l'âge, chacun trouve en soi la foi et une place pour Dieu en lien avec certaines circonstances.
Fille de 20 ans. La jeunesse est un âge où une personne avec une certaine vision du monde se forme et où l'athéisme se produit.
1 Ici, évidemment, l'intimé nous renvoie à la chanson bien connue du groupe de Leningrad "On Louboutins".
Jeune homme de 20 ans. C'est normal s'ils ne piquent pas la figure avec leur "cool athée". protester contre l'athéisme ? Une conséquence de la puberté tardive et des complexes infantiles.
Il est connu de l'histoire qu'en période de crise de la société, l'influence de la religion sur la vie publique et privée des gens s'étend, l'éventail de leurs croyances religieuses et non religieuses s'élargit et il y a une montée de toutes sortes de superstitions, l'occultisme et le mysticisme.
Nous observons ce phénomène aujourd'hui dans notre pays. On observe des exemples de « conversion » religieuse massive dans des groupes de population d'âges et de professions différents, mais elle est particulièrement perceptible chez les jeunes. C'est compréhensible, puisque la formation des orientations se déroule en elle. Pour elle, les conditions d'entrée dans la vie ont radicalement changé, les possibilités d'un développement social et civil à part entière sont considérablement limitées, elle a perdu les orientations sociales, morales et idéologiques. Le rôle des institutions de socialisation des jeunes a été considérablement affaibli, qu'il s'agisse de la famille, de l'école, du système d'enseignement professionnel, des organisations sociopolitiques, des mouvements, des médias et des communications. L'église occupe activement sa place dans cette rangée, introduisant quelque chose de nouveau dans le processus compliqué de la formation sociale des jeunes hommes et femmes.
Le client de ma recherche est l'Église orthodoxe russe. L'Église orthodoxe russe est maintenant confrontée au problème de la jeunesse russe qui ne fréquente pas l'Église orthodoxe et à la conversion des jeunes dans diverses associations religieuses occidentales et orientales. Dans les sectes (cultes - dans la terminologie occidentale), ils abusent de l'immaturité sociale, spirituelle et morale de la jeunesse moderne au nom de leur propre prédication ou des intérêts commerciaux ou même politiques de quelqu'un d'autre. L'Église orthodoxe, au contraire, n'attire pas, n'intéresse pas les jeunes.
L'objet de ma recherche est la jeunesse étudiante de Saint-Pétersbourg, car le sort futur de notre société dépend de la jeunesse, de ses attitudes morales, de ses orientations de valeurs, qui se forment souvent sous l'influence de la religion. Le but de ma recherche est d'étudier la religiosité des jeunes. Il est nécessaire d'identifier le pourcentage de jeunes croyants qui s'identifient à la dénomination orthodoxe, et aussi d'étudier l'attitude envers les normes religieuses et les représentants d'autres dénominations. Il est nécessaire de trouver des moyens de résoudre ce problème (non-fréquentation de l'église par les jeunes), d'élaborer des recommandations pratiques, pour cela il est nécessaire d'étudier l'attitude des jeunes vis-à-vis de l'organisation de l'enseignement religieux dans divers établissements d'enseignement, de l'organisation d'une assistance psychologique par des représentants de l'Église orthodoxe. Vous devez également connaître l'opinion des jeunes sur la réforme de l'Église orthodoxe, sur ce qui devrait être changé. Cela vous aidera à trouver des moyens de résoudre le problème.
Dans ma recherche, pour collecter des informations sociologiques sur la situation dans l'établissement, j'utiliserai un type d'enquête écrite - un questionnaire. Comme ce type d'enquête préserve l'anonymat du répondant, ce qui est très important lorsqu'on étudie la religiosité, l'enquête permet également de recueillir une grande quantité d'informations dans un laps de temps relativement court.
La sociologie de la religion est une science qui étudie la religion comme un phénomène social, c'est-à-dire qu'elle étudie la religion comme accessible aux méthodes de recherche empiriques développées en sociologie, le comportement social d'une personne (individus et groupes) : comment les groupes et institutions religieux se forment et fonctionnent , grâce à quoi ils persistent ou cessent d'exister, quelles sont les relations entre les groupes religieux, pourquoi des conflits surgissent entre eux, ce qui sous-tend les actions rituelles, etc.
Si la religiosité de la population dans son ensemble fait depuis longtemps l'objet de l'attention des sociologues russes, notamment à la veille et après le 1000e anniversaire du baptême de la Russie, des études sociologiques particulières sur la religiosité des jeunes ont commencé assez récemment. Le sujet de ces études sont les croyances des jeunes; son attitude envers la religion; l'activité religieuse, facteurs influençant la religiosité des garçons et des filles. En règle générale, l'objet de ces recherches est les jeunes (15-30 ans) qui étudient dans divers établissements d'enseignement. Tous les sociologues signalent une augmentation de la religiosité des jeunes à l'heure actuelle, par rapport aux années 80, mais un certain pourcentage de jeunes Russes se tournent vers des activités dans des organisations religieuses non traditionnelles, dont la plupart sont destructrices.
La sociologie de la religiosité juvénile est une discipline sociologique particulière qui se forme à l'intersection des études religieuses, de la sociologie de la religion et de la sociologie de la jeunesse et d'autres disciplines.
Le sujet de la sociologie de la religiosité des jeunes est l'étude de l'état, de la typologie et des tendances dans la formation de la conscience religieuse, y compris la foi, les idées de vision du monde, les expériences et les connaissances, ainsi que l'expérience et le comportement religieux des jeunes (à l'âge allant de 15 à 30 ans) sous des formes individuelles, de groupe et de masse.
Le concept central de la sociologie de la religion dans le milieu des jeunes est la « religiosité des jeunes », qui implique, tout d'abord, l'identification du degré de familiarisation des jeunes avec les valeurs et les systèmes religieux. Mais le problème de l'incroyance et de la laïcité des jeunes ne doit pas rester en dehors du champ de vision du sociologue. Les trois concepts - « religiosité », « non-religion » et « laïcité » - représentent un tout organique, en raison de la relation de leur contenu : « La religiosité, présentée comme une certaine forme ou degré de conscience religieuse, l'expérience et le comportement des jeunes peuple, est le concept de base sur lequel le sujet retient l'attention du sociologue, car sans l'étude de la religiosité, l'étude de la non-religion perd son sens. La non-religiosité, considérée comme un reflet ontologique de la religiosité, représente le degré et la forme d'une attitude neutre, indifférente ou radicalement négative à l'égard de la religiosité. Une personne vraiment non religieuse, pour les raisons les plus naturelles, peut même ne pas penser au problème de la religiosité. La laïcité, vue comme le degré et la forme de participation des jeunes à la libération de l'emprise de la religion, son système de valeurs et de normes, reflète très probablement une véritable transition de la religiosité à la non-religiosité.
La division des personnes selon la nature de la religiosité en « croyants », « hésitants » et « non-croyants » est déjà, bien que grossière, sans nuances, mais reste le principal « renfort » de la religiosité étudié par la sociologie. Derrière ces différences purement intenses se cache un contenu qualitativement différent. Il faut ici reconnaître la discrétion qualitative de ceux qui ne se prêtent pas à l'opérationnalisation sociologique de « l'incrédulité » à une attitude religieuse, de celle-ci à la laïcité, et de celle-ci à la religion à travers le déni athée ou le principe de la liberté de conscience, et donc à tolérance religieuse au sein même de l'Église. C'est la source de la variété originelle des types de religiosité. La difficulté est que les problèmes de conscience, la psychologie individuelle de la foi sont entrelacés avec de nombreuses formes d'organisation du mode de vie religieux. La religiosité et la laïcité diffèrent l'une de l'autre non seulement et pas seulement par le type de conscience et de comportement (ce qui, bien sûr, est certainement important), mais par la nature de l'institutionnalisation. Pour bien comprendre cela, il faut se tourner vers la définition des concepts mêmes de « religion » et de « sécularisation ».
La religion est une institution socio-culturelle et historique complexe, qui comprend des systèmes : 1) conscience religieuse (croyances) ; 2) culte religieux (cérémonies) ; organisations religieuses (institutions) et remplit un certain nombre de fonctions dans la société - sens, intégration sociale, communication et contrôle social.1
La sécularisation est le processus de libération du contrôle religieux dans les affaires du monde, la libération d'une personne du pouvoir de la religion, la libération de diverses sphères de la vie publique de l'influence de la religion et de l'église, de sa réglementation par les normes religieuses.
La « stratification » religieuse de la jeunesse s'avère extrêmement importante pour déterminer le contexte évolutif des destins historiques de la société, car la fabrication de sens est l'une des principales fonctions sociales de la religion. Et ici, la question n'est pas seulement de savoir quelle croyance spécifique, ou le sens de l'organisation évolutive, devrait prévaloir, mais avant tout, c'est la jeunesse, bien qu'à différentes phases des cycles générationnels, qui s'avère d'une manière ou d'une autre être à la fois une source substantielle et l'exécutant final de la définition sémantique de la société. Bien sûr, la jeunesse en tant que sujet clairement exprimé de création de sens (à la fois séculier et religieux) se manifeste précisément à l'ère de l'état dynamique de l'histoire, où l'on peut vraiment parler de l'identité de la juventocratie (le pouvoir des jeunes), contrairement aux périodes de relative stabilité ou de stagnation, lorsque la fonction de création de sens est monopolisée par des tranches d'âge plus matures.
Dans la sociologie classique de la religion, malheureusement, aucune attention particulière n'a été accordée aux caractéristiques des processus religieux et laïcs dans l'environnement des jeunes ; cela est plus typique pour les chercheurs de la fin du XXe siècle, lorsque l'issue de la lutte pour la jeunesse des les structures dirigeantes et idéologiquement contrôlantes et les conséquences de la lutte des jeunes eux-mêmes pour la liberté d'autodétermination revêtent une importance particulière pour le destin du XXIe siècle.
L'étude de la religiosité des jeunes est aujourd'hui nécessaire, car ce sont les jeunes, par leur nature sociale, qui représentent un reflet « holographique » de toutes les contradictions et possibilités des dynamiques socio-historiques et culturelles de la société à une certaine échelle. de la réalité sociale (leur patrie, leur pays, une certaine communauté socioculturelle). En ce sens, la jeunesse est une sorte de code phénotypique de l'évolution d'une société particulière. C'est la jeunesse qui choisit la trajectoire du mouvement historique de la société.
Ministère de l'éducation et des sciences de la Fédération de Russie
"MATI" - Université technique d'État russe du nom de K.E. Tsiolkovski
Département d'études culturelles, d'histoire, de politique de la jeunesse et de publicité
Cours sur les méthodes de recherche globale et d'évaluation de la situation des jeunes dans la société sur le thème :
Religiosité de la jeunesse d'aujourd'hui
Élève : Kovalenko O.V.
7ORM-2DS-034
Conférencier : Professeur
Zoubkov V.I.
Moscou 2010
Présentation……………………...……………………………………….……3
1. Le rôle et la place de la religion dans le monde moderne………………….……5
La religion et ses formes d'organisation……………………………….....5
La sociologie de la religion comme branche du savoir sociologique ....... 9
Le choix des jeunes d'aujourd'hui .................................................. ....................... .......12
Recherche sociologique .................................................. .............. ..... quatorze
Partie méthodologique .................................................. ...............................17
2. Etude empirique…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
2.1. Interprétation des concepts de base .................................................. ................ ..19
2.2. Analyse systémique de l'objet d'étude .................................................. ... 22
2.3. Volet organisationnel et méthodologique .......................................23
2.4. Généralisation. Analyse des données empiriques.................................25
Conclusion................................................. .................................................. .27
Liste bibliographique .................................................. .................................................trente
Application................................................. ...............................................31
Introduction
Tout d'abord, je voudrais expliquer pourquoi ce sujet est pertinent à notre époque.
L'un des aspects importants de la vie quotidienne est la religion, qui laisse une empreinte notable sur les valeurs, les coutumes, les comportements, l'éthique du travail, les orientations culturelles et sociales. Ce n'est pas un hasard si la société russe au cours des siècles s'est distinguée par le fait qu'un rôle important dans sa vie appartenait à l'Église orthodoxe. Cependant, la vie moderne met en évidence de nouvelles facettes et aspects d'anciens problèmes et, surtout, actualise la question - le renouveau religieux a-t-il eu lieu en Russie après tout ce qui a été vécu ?
Au XXe siècle. La Russie avait une place pour être un phénomène tel que le socialisme. Nous n'entrerons pas dans les détails pour savoir si cela est bon ou mauvais, mais nous noterons seulement qu'à cette époque, il y avait l'athéisme d'État, les croyants étaient condamnés, les ministres de l'église étaient persécutés.
En 1991, tout a changé : le pays a disparu, le socialisme a disparu, mais qu'en est-il de la foi ? Elle est de retour? Qu'en pense la nouvelle génération ? Votre propre foi est-elle plus proche des filles et des garçons russes ? Ou préfèrent-ils d'autres religions ?
Matière dans ce numéro est l'étude de la religiosité de la jeunesse moderne.
objet est la jeunesse moderne (intervalle d'âge 17-22 ans).
Buts:
Déterminer le niveau de religiosité de la jeunesse moderne ;
Étude de l'état, de la typologie et des tendances de la formation de la conscience religieuse ;
Étudier les sources de soutien moral des jeunes d'aujourd'hui.
Tâches:
Étudier la religiosité de la jeunesse en général ;
Explorer les besoins des jeunes dans l'Église orthodoxe ;
Déterminer le niveau d'accessibilité de la littérature religieuse en général ;
Enquêter sur les besoins des jeunes en littérature religieuse ;
Déterminer la fréquence de fréquentation de l'église par les jeunes d'aujourd'hui.
Les répondants de l'enquête sociologique étaient 30 personnes, étudiants de diverses universités et collèges de Moscou.
Le questionnement a été choisi comme méthode d'enquête sociologique, car il permet de préserver l'anonymat du répondant et de recueillir une grande quantité d'informations dans un laps de temps relativement court.
Situation problématique.
La religiosité de la jeunesse d'aujourd'hui est au plus bas, l'Église orthodoxe n'attire pas les jeunes. Mais seule l'église peut aider à raviver l'ancienne spiritualité et la religiosité du peuple russe. Une autre mesure pour surmonter l'aliénation des jeunes vis-à-vis de la religion devrait être l'introduction d'un cours d'études religieuses dans divers établissements d'enseignement.
1. Le rôle et la place de la religion dans le monde moderne
1.1. La religion et les formes de son organisation
Pour un sociologue, la religion existe en tant qu'entité sociale, c'est-à-dire pas seulement comme un ensemble de croyances, d'idées, d'enseignements, mais comme un groupe de personnes qui partagent ces croyances. Les idées religieuses ont toujours leur porteur, et ce porteur est une sorte de communauté sociale. Le porteur social de la religion n'est pas nécessairement un groupe précisément défini de personnes qui appartiennent à cette religion et s'unissent selon ce seul critère - l'appartenance à cette religion. De telles religions organisées apparaissent relativement tard dans l'histoire du développement religieux.
Pendant une longue période, couvrant les religions primitives et archaïques, pour reprendre la terminologie de R. Bell, le porteur social de la religion n'a pas été un groupe religieux spécifique, mais une société dans laquelle la différenciation sociale commence à peine à se développer et qui se caractérise par certaines manifestations religieuses, caractéristiques, ainsi que d'autres. . Il y avait et il y a encore des sociétés qui ne connaissaient pas d'organisations religieuses pouvant être qualifiées d'"églises".
Historiquement, les premières communautés religieuses sont des communautés de type « vital », comme la famille, le clan, la tribu, le peuple, l'État. Ces communautés possèdent elles-mêmes, dotées d'un caractère sacré. Leur appartenir est vécu comme l'unité de tous avec tous et donne un sentiment de contact avec la base de la vie. Et à des stades ultérieurs, dans les sociétés de l'Orient ancien, par exemple, la structure étatique et religieuse coïncidait. L'appartenance religieuse se définit ici non pas par l'appartenance à un système de croyance ou à un groupe religieux spécifique, mais par l'appartenance à un ensemble social donné. Ces religions sont appelées « religions populaires », ce qui signifie que leur support social, leur « corps », est le peuple en tant que communauté naturellement donnée, « vitale », ou bien - la « religion diffuse » (ce concept, contrairement à la « religion organisée », introduit par J. M. Yinger ; il voulait dire, en parlant de « religions diffuses », la religion d'une société tribale.) On peut dire que la religion existe sous une forme aussi diffuse même dans une société hautement différenciée, disons, la Grèce et la Rome antiques, la professionnalisation religieuse apparaît, les rôles spécialisés des prêtres et même leur organisation - et pourtant il n'y a toujours pas de trait distinctif principal de la religion organisée - la religion n'a pas encore développé son "corps social" spécifique, une forme d'organisation sociale, mais n'existe encore qu'en tant que partie de la culture ce groupe, la société. L'appartenance religieuse est définie comme une appartenance ethnique, étatique, comme un rôle attribué par la naissance. Les rituels religieux sont inscrits dans les cycles de vie et le calendrier saisonnier. Les toutes premières organisations religieuses se créent dans de telles sociétés à religion diffuse, principalement parmi de petits groupes déviants qui cherchent à s'isoler de la « grande société » en synthétisant leur religion avec leur vie sociale, c'est-à-dire créer une société religieuse spéciale, leur propre organisation religieuse.
Une organisation au sens sociologique général est un groupe social formé pour atteindre certains objectifs. Les membres de ces groupes jouent certains rôles et entre eux il n'y a pas de relations personnelles, émotionnellement colorées, mais purement formelles et rationalistes. Caractéristiques typiques de l'organisation - division du travail, division du pouvoir, délégation de responsabilité. Ces signes s'appliquent également à diverses organisations religieuses, du moins déjà assez matures. une
« L'un des fondements importants de toute culture nationale est la religion. Les institutions religieuses participent activement et efficacement à la formation du monde spirituel de l'homme. Dans des conditions de développement instable de la société, la popularité des religions et des cultes augmente particulièrement. Ne trouvant pas de solutions à leurs grands et petits problèmes dans ce monde, de nombreux citoyens (les jeunes ne font pas exception) regardent avec espoir vers un autre monde. 2
« Dans la sociologie moderne de la religion, les définitions fonctionnelles sont présentées sous diverses modifications. Ainsi, M. Yinger a défini la religion comme un système de croyances et de pratiques à l'aide duquel tel ou tel groupe de personnes fait face aux « derniers », « ultimes » problèmes de la vie humaine : c'est un refus de capituler devant la mort, la capacité à surmonter la déception, à ne pas permettre à l'inimitié de triompher dans les relations humaines et de détruire la communauté humaine… La religion est ainsi interprétée comme une solution à ces problèmes mêmes, une solution au problème du sens religieux de la vie et de la mort. 3
Au cours de la dernière décennie du XXe siècle. La structure de l'espace religieux en Russie a considérablement changé. Au début des années 1990. elle n'était représentée que par 15 à 20 directions religieuses. Comme les porteurs historiques de certaines religions étaient des ethnies indigènes ou des groupes d'ethnies, les aires de leur peuplement traditionnel historiquement établi étaient en même temps les aires de diffusion des religions qu'ils professaient. La société moderne se caractérise par une tendance à la croissance de la diversité religieuse, qui est associée à un changement dans la structure nationale de la population des régions, l'ouverture externe et interne du pays. Aujourd'hui, presque toutes les régions de Russie sont habitées par des personnes d'au moins 50 à 60 nationalités - adeptes de 20 à 30 confessions religieuses.
À cet égard, l'analyse des tendances d'intégration ou de désintégration dans la société russe moderne, en tenant compte du rôle des institutions religieuses chrétiennes, met en avant le potentiel de conflit interreligieux comme principale catégorie analytique. Dans le même temps, les tendances conflictuelles panrusses n'ont pas encore de base religieuse, car elles reposent sur des problèmes sociaux aigus, alors qu'aucune des confessions n'a encore été en mesure d'exprimer l'idée de protéger la justice sociale dans le langage de la doctrine religieuse et de l'habiller d'une forme accessible aux masses. Il convient également de prendre en compte le facteur d'orientation non religieuse d'un groupe stable de la population de la Russie post-soviétique (jusqu'à 50% de la population), qui est enregistré par des enquêtes sociologiques.
Le rôle et l'influence du facteur chrétien dans la Russie moderne sont principalement liés à l'auto-identification religieuse d'une partie de la population et au niveau de religiosité (c'est-à-dire la part des croyants dans la composition totale de la population du pays). Cependant, des difficultés pour leur étude sont créées par le fait que la composition religieuse de la population au XXe siècle. n'a été spécialement étudié qu'une seule fois - lors du recensement de 1937, lorsque plus de la moitié de la population de l'URSS a déclaré sa religiosité. Lors du recensement panrusse de la population de 2002, malgré les propositions des scientifiques de l'Académie russe des sciences, il n'y avait aucune question sur l'appartenance confessionnelle.
En conséquence, les services officiels (ministère de la Justice, Goskomstat) ne disposent pas aujourd'hui de données actualisées, complètes et fiables sur le nombre de croyants tant dans le pays dans son ensemble que dans les régions et les confessions religieuses. En l'absence de données statistiques sur l'appartenance religieuse individuelle, le nombre d'organisations religieuses de la direction correspondante enregistrées auprès des autorités judiciaires russes et les données d'enquêtes sociologiques peuvent servir de sources pour déterminer le nombre d'une confession particulière.
1.2. La sociologie de la religion comme branche du savoir sociologique
« La place assignée par les sciences sociales à l'étude de la religion a longtemps été assez curieuse. La pression idéologique et la protection idéologique dominaient en même temps la science de la religion. Cette science était dominée par des formulations théoriques très importantes et souvent simplement brillantes. Il contenait une description théorique et, en même temps, une attitude dédaigneuse envers de nombreuses questions relevant de son champ d'application. De plus, presque aucune attention n'a été accordée au pain quotidien de toute science, à savoir la vérification des déclarations théoriques les plus importantes à l'aide d'observations de contrôle.
Cette situation a commencé à changer avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En Europe et en Amérique, l'étude scientifique de la religion gagne un soutien de plus en plus tangible. De simples généralisations sur les institutions religieuses et les comportements religieux sont remplacées par des analyses détaillées dominées par des comparaisons précises. Il est de plus en plus nécessaire de prendre en compte les différences de classe, d'éducation et d'autres faits sociaux afin de faire des généralisations plus précises sur l'influence religieuse ou, inversement, l'influence sur la religion. A cette époque, un certain nombre de revues spécialisées sont apparues, traitant de la publication de recherches dans le domaine de la religion.
Un certain nombre de questions soulevées par les recherches en sociologie des religions à cette époque ont montré que cette discipline n'est pas une sorte de secret accessible aux seuls spécialistes initiés, travaillant dans un cadre strictement défini d'intérêt scientifique. Au contraire, l'étude de la sociologie de la religion implique de travailler dans les domaines les plus importants, l'analyse de la société et de la culture dans un contexte pertinent à une certaine période de temps. Sans l'étude la plus minutieuse des groupes religieux et des comportements religieux, il est impossible d'aborder les problèmes de stratification sociale, de changement social, de relations intergroupes, de sociologie politique, de bureaucratie, de consensus et de dissensus sociaux, de sociologie des conflits, d'étudier les processus évolutifs de nations et communautés nouvellement formées - et c'est loin d'être complet - liste des problèmes scientifiques liés à la sociologie de la religion.
L'étude de la société doit être l'étude de la religion, et l'étude de la religion doit être l'étude de la société. La sociologie des religions est l'une des branches de la sociologie scientifique. C'est le lien entre la théologie et la sociologie ; la religion est un fait initial fini, une base, et la sociologie permet de la comprendre scientifiquement.
La sociologie de la religion ne dépend pas des orientations de valeurs des sociologues, elle est objective et impartiale. Il étudie des phénomènes empiriques en tentant de généraliser sur les relations entre le comportement religieux et d'autres types de comportement social.
La sociologie de la religion opère avec un ensemble d'affirmations intégrées et vérifiables qui sont cohérentes avec le cadre théorique plus large de la sociologie générale. Les hypothèses avancées doivent être explicites, précises et formulées de telle manière qu'il reste possible de les tester empiriquement.
Le chercheur doit, avant tout, avoir une compréhension tout à fait adéquate de la théorie sociologique moderne et des méthodes de sa recherche. Il doit être absolument objectif dans ses interprétations des faits religieux ; de plus, il doit s'intéresser profondément à la matière étudiée et bien la connaître. Parmi les sociologues, il y a ceux qui se considèrent « religieux », d'autres « anti-religieux », et d'autres encore qui sont plutôt indifférents à la religion. Les sociologues des deux premiers groupes souffrent souvent d'un manque d'objectivité, et le troisième - d'un manque d'intérêt pour le développement de la sociologie de la religion.
Les scientifiques impliqués dans la sociologie de la religion, ignorant la théorie et la méthodologie sociologiques, peuvent néanmoins faire de nombreuses observations utiles et précises, mais leurs découvertes sont peu susceptibles d'apporter quelque chose de nouveau au développement de la théorie sociologique de la religion, car les problèmes qu'ils soulèvent sont structurés. différemment que cela exige la théorie sociologique conventionnelle.
Malgré l'offre presque inépuisable d'informations sur les religions primitives et civilisées, sur l'histoire de l'Église, sur les mouvements sectaires et l'énorme quantité de documents religieux sous forme écrite, tels que les sermons, les publications officielles des paroisses, etc., il existe une grand manque de matériel empirique, sans lequel il est difficile de faire des généralisations adéquates. De plus, il est très difficile de juger de la validité de la plupart des données disponibles. Presque toutes les informations qui nous sont parvenues sur les religions primitives sont basées sur l'observation d'une seule personne et sont totalement non vérifiées par d'autres chercheurs.
Les théories détaillées de la sociologie de la religion se construisent principalement sur des archives qui nous sont parvenues il y a deux, trois ou vingt-cinq siècles, quand le problème de la vérification, de la fiabilité, et surtout le problème de la complétude du reflet de la réalité religieuse ne ne se pose pas. Cela, bien sûr, ne signifie pas qu'aucune théorie cohérente ne peut être construite sur la base de l'étude d'un tel matériel, mais seulement qu'il est inacceptable de tirer des conclusions définitives dans ce cas.
De plus, la plupart des données disponibles et acceptables pour une utilisation par les sociologues de la religion, il n'y a rien à comparer, comparer, et, par conséquent, ce genre d'informations est pratiquement invérifiable. Avec de telles données, il est très difficile de généraliser et de tirer des conclusions.
Un autre problème lié à cela est que les données qui sont collectées sans être guidées par un certain concept scientifique ont le plus souvent très peu de valeur scientifique. Idéalement, le matériel empirique devrait être recueilli en relation avec des hypothèses vérifiables. Mais seule une infime partie des informations sur lesquelles le sociologue des religions doit travailler répond à cette exigence, qui remporte en réalité un succès considérable.
Bien sûr, cette utilisation d'hypothèses est pleine de dangers considérables. Cependant, un tel risque peut difficilement être évité en se livrant à un empirisme nu ou en n'utilisant que des données qui sont corrélées dans le processus de collecte avec d'autres hypothèses - cachées ou explicites, implicites ou explicites. quatre
1.3. Le choix des jeunes d'aujourd'hui
Une analyse de la religiosité de la jeunesse russe nous permet d'affirmer quelque chose de nouveau - par rapport aux données de la période pré-perestroïka
phénomène. Il s'agit de dépasser les stéréotypes négatifs qui existaient auparavant chez les jeunes, implantés par les programmes scolaires et l'éducation athée en général (tels que « la religion entrave le développement de la science », « la religion est le lot des vieilles femmes », etc.) .
Aujourd'hui, toutes sortes de programmes destinés à la jeune génération sont menés très activement. Par exemple, ces jours-ci, la procession religieuse des jeunes "Sainte Intercession", organisée par l'Église orthodoxe russe, a lieu. De leur côté, les jeunes musulmans de Moscou ont organisé un iftar (repas de cérémonie) le 21 septembre dans l'un des cafés de la capitale. Et quant aux actions diverses contre la toxicomanie ou la propagation du sida, elles sont innombrables. Les protestants sont particulièrement actifs dans ce domaine.
Bien sûr, tout cela résonne dans le cœur des jeunes. Beaucoup, par exemple, cherchent à mieux connaître l'Islam sans avoir peur de l'image négative qu'on lui impose. D'autres jeunes, guidés par leurs propres motivations, tournent leur regard vers le christianisme. Une activité missionnaire active est menée par l'organisation de jeunesse orthodoxe "Pokrov", opérant dans l'une des églises de Yasenevo.
Il est incroyablement difficile de dire exactement quels facteurs contribuent à la popularité d'une croyance particulière. C'est encore plus difficile de dire ce que les jeunes n'aiment pas. Il est tout simplement impossible de choisir rationnellement une "foi à votre goût", comme, par exemple, une chaise ou une voiture. Il y a d'autres mécanismes à l'œuvre ici.
Le jeune esprit est ardent, souvent pas pris par la sévérité majestueuse du christianisme ou de l'islam. Maximalisme juvénile, doublé d'un esprit d'opposition à la culture de masse, la "pop" entraîne les têtes brûlées dans la jungle des nouveaux mouvements religieux. C'est là que vous pouvez faire demi-tour, surtout si l'on considère que l'intérêt pour toutes sortes de connaissances occultes et ésotériques est alimenté par les médias modernes. D'innombrables émissions quasi scientifiques, résolvant un mystère après l'autre, soulèvent en fait plus de questions qu'elles ne trouvent de réponses.
L'occultisme et l'ésotérisme ont toujours impressionné et continueront d'impressionner les jeunes esprits inexpérimentés. Intrigue, passion de savoir ce qui n'est pas accessible aux autres, une touche de mystère. Grande est la tentation de s'intéresser à tout cela. La mode de la réalité alternative fait son travail : une passion pour la science-fiction et le fantastique, les jeux de rôle de tous bords. La frontière entre réalité et fiction est parfois si mince qu'elle devient indiscernable. Un autre catalyseur est les sorciers, sorcières et magiciens héréditaires et locaux, les guérisseurs et les médiums qui viennent de nulle part.
La littérature disponible (et dans les librairies il y a maintenant des stands séparés, appelés «ésotérisme») peut transformer la passion pour la magie de la divination de Noël sur de la cire fondue en une affaire, sinon pour toute une vie, mais, en tout cas, pour de nombreuses années . En effet, il existe des groupes de jeunes qui mènent divers rites et rituels magiques lors de leurs réunions. De plus, beaucoup de ces groupes ne sont pas le fruit d'un passe-temps d'une journée de trois camarades de classe, mais des communautés à part entière avec une hiérarchie, des rites d'initiation et une doctrine.
Ce n'est un secret pour personne que les jeunes forment souvent des sous-cultures pour divers motifs, en règle générale, la musique agit comme un tel critère. Il arrive souvent qu'une sous-culture offre une image du développement spirituel de son adepte. Chez les fans de musique lourde, le néo-paganisme et le satanisme (au sens très large) sont plus répandus que chez les représentants des autres mouvements de jeunesse. Qu'est-ce qui amène les jeunes à un temple ou à une messe noire ? Cercle social, mode, ou peut-être une vraie foi en Svarog et Veles ? Les réponses peuvent varier.
1.4. recherche sociologique
"Si même il y a 10-15 ans, parmi tous les groupes d'âge, l'indicateur de religiosité le plus bas (1-2%) était chez les jeunes (chez les adultes - environ 10%), maintenant les différences d'âge n'affectent pas la religiosité de la population dans toute manière perceptible. Cela ressort des réponses des répondants de tous les groupes de vision du monde. Ainsi, parmi les jeunes interrogés, ceux qui croient en Dieu étaient 32,1% et parmi les adultes - 34,9%; ceux qui hésitent entre la foi et l'incrédulité - 27 % et 27,6 %, respectivement ; indifférent à la religion - 13,9% et 14,7%; non-croyants - 14,6% et 13,5%.
Une différence relativement notable n'est enregistrée que parmi ceux qui croient aux pouvoirs surnaturels (respectivement 12,4 % et 9,3 %), qui serait associée à la fascination des jeunes pour diverses formes de religiosité non traditionnelle, y compris le mysticisme non religieux (croyance en la communication avec
esprits, magie, charlatanisme, divination, sorcellerie, astrologie). Le développement de l'intérêt noté pour l'occultisme, les tendances ésotériques, qui augmentent toujours à des époques de changements sociaux drastiques, est également facilité par la littérature occulte qui a récemment été largement distribuée.
Pour une compréhension objective du rôle et de la place de la religion dans l'esprit des jeunes, il est également important de prendre en compte le fait qu'un nombre important de jeunes - non seulement des croyants en Dieu, mais aussi des représentants d'autres groupes de vision du monde, y compris les indifférents et les non-croyants - se considèrent comme des partisans des religions traditionnelles.
Ici, entre autres raisons, il existe un lien étroit entre la conscience religieuse et la conscience nationale. Niant leur religiosité dans leur auto-identification idéologique, les jeunes se considèrent en même temps comme des adhérents des associations religieuses traditionnelles. Ainsi, l'orthodoxie ou l'islam est perçu non seulement comme un système religieux proprement dit, mais comme un environnement culturel naturel, un mode de vie national ("russe - donc orthodoxe", "tatare - donc musulman"). Ainsi, non seulement 56,2 % des hésitants, 24,1 % de ceux qui croient aux pouvoirs surnaturels, mais aussi 8,8 % des indifférents et même 2,1 % des jeunes incroyants se sont classés comme orthodoxes.
La vision religieuse de nombreux jeunes est plutôt vague et floue. Par exemple, 32,7 % des chrétiens orthodoxes, 30,0 % des musulmans et 14,3 % des protestants se sont classés comme hésitant entre la foi et l'incroyance ; aux croyants aux pouvoirs surnaturels : 6,5 % orthodoxes, 6,7 % musulmans, 6,3 % catholiques, 10,0 % juifs et 37,7 % croyants qui n'appartiennent à aucune confession particulière. 5
Cette thèse est à peu près également répandue dans l'opinion publique des jeunes appartenant aux groupes de vision du monde les plus divers, ainsi que dans les groupes confessionnels.
Ainsi, la majorité des jeunes, considérant positivement l'influence croissante des organisations religieuses, expriment en fait le souhait que les organisations religieuses définissent clairement leur place dans la vie publique et ne s'ingèrent pas dans des domaines qui échappent à leur compétence.
« La position plus restreinte des jeunes croyants est évidente sur plusieurs points. Par exemple, à la question de savoir s'ils aiment généralement la vie d'aujourd'hui en Russie, un "oui" inconditionnel a été exprimé par 9,2% des croyants et 6,8% des non-croyants.
Certaines différences entre les jeunes croyants et non croyants se reflètent également dans le degré d'intérêt pour la politique (dans le groupe
il y a 1,5 fois plus d'incroyants que dans le groupe des croyants, ceux qui
surveille l'information politique dans le pays), ainsi que le degré de participation à
travail des partis politiques, rassemblements, manifestations, grèves, etc. (en
au cours de la dernière année, un groupe de non-croyants a participé à de telles actions deux fois plus). Les données fournies montrent que les croyants sont moins enclins à ouvrir des formes de protestation : en cas de dégradation significative de la vie des jeunes et de leurs familles, 8,2 % des croyants en Dieu, 4,9 % de ceux qui hésitent, 4,1 % des croyants sont prêts à prendre part à diverses actions de protestation contre les forces surnaturelles, 9,5 % d'indifférents à la religion et 15,7 % de non-croyants. 6
« Ainsi, la religiosité, comme toute la vision du monde de la jeunesse moderne, a une structure plutôt complexe. Avec une augmentation générale du nombre de croyants par rapport aux décennies précédentes, chez les jeunes une part assez importante (plus de 50%) des indécis se révèle - ceux qui hésitent entre foi et incrédulité, ainsi que les indifférents et croient au surnaturel impersonnel les forces. La vision du monde de type non religieux continue d'occuper une place importante dans l'esprit des jeunes. Les jeunes religieux eux-mêmes sont plus favorables à la préservation des valeurs familiales et nationales et, malgré leur souci des réalités socio-politiques d'actualité, ne sont pas prêts à l'heure actuelle pour leur altération décisive. sept
1.5. M volet méthodologique
La meilleure façon d'étudier ce problème est par le biais d'une enquête. La source d'information dans ce cas peut servir de jugement verbal ou écrit d'une personne. Sur la base de notre sujet, il est préférable de choisir un questionnaire comme méthode d'enquête, dans laquelle la communication entre le sociologue-chercheur et le répondant, qui est la source des informations nécessaires, est médiatisée par un questionnaire. Le questionnaire est un système de questions unies par un concept de recherche unique visant à identifier les opinions et les évaluations des répondants et à obtenir d'eux des informations sur des faits, des phénomènes et des processus sociaux. Le questionnaire a une structure stricte et se compose de plusieurs parties. Le premier - introductif - est un appel direct à l'intimé. Il décrit brièvement les buts et les objectifs de l'étude, souligne son importance et décrit comment les résultats seront utilisés. Voici les règles pour remplir le questionnaire et l'anonymat des réponses est obligatoirement garanti.
La deuxième partie du questionnaire est la principale. Il contient des questions (leurs blocs), des indications pour obtenir les informations nécessaires. Puisque le questionnaire doit contribuer à la solution de plusieurs tâches, il est préférable que chacune d'elles ait son propre bloc de questions. Ainsi, il est possible d'identifier la relation de la personne examinée avec les gens, son propre comportement, les événements ; déterminer le niveau culturel, les caractéristiques de la conscience morale et juridique, le niveau de développement de l'intellect, etc.
Le thème de la foi est un aspect plutôt intime de la vie humaine. Le questionnaire offre l'anonymat, dans le cadre duquel le niveau de fiabilité des données obtenues à la suite de l'enquête augmente.
2. recherche empirique
2.1. Interprétation des concepts de base :
Problèmes affectant la religiosité de la jeunesse russe moderne.
Socialisations primaires :
Athéisme chez les proches
Avoir une éducation religieuse
État moral et psychologique dans la famille
Attitude envers la religion dans la famille
Traditions religieuses dans la famille
Traditions de lecture des prières en famille
Croyances personnelles :
Visite de l'église
Disponibilité de la littérature religieuse à la maison
La présence d'objets religieux à usage domestique
Intérêt pour la religion
Croyance aux médiums et au surnaturel
Raisons possibles du manque de littérature religieuse à la maison :
Athéisme chez les parents
Raisons possibles du manque d'objets religieux à la maison :
Athéisme chez les parents
Manque de combinaison avec l'intérieur de la maison
La religiosité de la jeunesse moderne est déterminée par les positions suivantes :
Satisfaction morale après avoir communiqué avec des clercs
Éducation
Prières en famille
Traditions des fêtes religieuses dans la famille
Disponibilité de la littérature religieuse
La présence d'objets de culte à la maison
Le besoin de foi
Les facteurs qui influencent la religiosité de la jeunesse d'aujourd'hui peuvent être divisés en objectifs et subjectifs.
Les objectifs comprennent la religiosité des parents, l'éducation de l'enfant, l'enseignement de l'histoire de la religion dans les établissements d'enseignement, la compagnie des pairs, les traditions religieuses familiales, etc.
Aux croyances intérieures subjectives - personnelles de l'individu.
Tous les croyants peuvent être divisés en deux groupes : actifs et passifs.
Les croyants actifs sont ceux qui, avant tout, vont à l'église, jeûnent, gardent les commandements, etc.
Passif - croire simplement en Dieu sans observer aucune tradition religieuse.
L'analyse de l'objet de cette étude nous permet de formuler les hypothèses suivantes.
Hypothèse générale.
La religiosité de la jeunesse d'aujourd'hui est déterminée par la religiosité de la famille.
L'hypothèse générale se révèle à travers un certain nombre d'hypothèses particulières :
Les jeunes du monde moderne sont moins susceptibles de se tourner vers leurs parents pour obtenir de l'aide et du soutien.
Les traditions des fêtes religieuses dans les familles disparaissent
L'interdiction de la religion à l'époque du socialisme laisse également une empreinte d'athéisme dans le monde moderne.
L'absence d'un cours d'histoire de la religion dans les établissements d'enseignement ne permet pas d'acquérir des connaissances supplémentaires sur la Foi
Les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus engagés dans leurs affaires personnelles. La fréquentation de l'église n'est pas incluse dans leurs plans.
Les jeunes ne sont pas habitués à se tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide, car ils n'ont pas reçu d'éducation religieuse à la maison
Toutes sortes de théories scientifiques sur l'origine de l'homme prouvent de toutes les manières possibles que l'homme ne vient pas de Dieu. Cela réfute l'authenticité de la Bible.
2.2 Analyse systémique de l'objet d'étude
Moral
Support
Parents
Psychologue
Prêtre
religiosité
religieux
les attributs
Articles
religieux
Littérature
catholicisme
protestantisme
Médiums
Orthodoxie
2. 3. Volet organisationnel et méthodologique
Plan stratégique et méthode de recherche.
Il est prévu de mener une étude analytique et expérimentale, car il existe des données pour formuler des hypothèses explicatives, et donc la capacité d'identifier les relations fonctionnelles et causales de l'objet à l'étude avec le développement ultérieur d'une prévision de son état futur et des recommandations pour des mesures d'optimisation sociale et managériale.
La méthode de collecte des données empiriques est une enquête sous forme de questionnaire collectif. Le groupe d'étude des étudiants agit comme un groupe d'enquête dont les membres rempliront simultanément des questionnaires en classe. Le choix de la méthode et de la méthodologie de l'étude est dû au fait qu'il est nécessaire d'interviewer un grand nombre de répondants (étudiants universitaires) en peu de temps.
Conformément aux dispositions du volet méthodologique du programme de recherche, le questionnaire comprend les blocs de questions suivants :
Partie contact (religiosité de la jeunesse)
Religiosité familiale
Sources de soutien moral
Caractéristiques socio-démographiques ("passeport")
Opérationnalisation des concepts de base.
pièce de contact - religiosité des jeunes.
Croyances religieuses personnelles
Attitude envers la religion
Traditions
Religiosité familiale :
Présence d'attributs religieux à la maison
Traditions religieuses de la famille
Éducation religieuse
Sources de soutien moral :
Parents
Psychologue
Prêtre
Caractéristiques socio-démographiques :
Le niveau d'éducation
Lieu d'étude
Justification de l'échantillonnage.
Compte tenu de la présence d'une population générale importante (9000 personnes), il est conseillé de mener une étude par échantillonnage. La pratique à long terme des enquêtes de masse montre qu'avec la taille de la population générale de 5000 personnes. et plus d'échantillonnage devrait être de 10%, mais pas plus de 2000-2500 personnes 8 .
Nous utilisons un échantillonnage emboîté sur l'exemple de l'Université technique d'État de Russie : dans chaque faculté, un ou deux groupes d'étudiants sont sélectionnés dans chaque cours. Ainsi, le nombre total de répondants devrait être d'au moins 30 personnes. 9 000 étudiants étudient à la RSTU dans 7 facultés. En moyenne, chaque faculté de chaque cours compte 10 groupes. De chaque cours, nous interviewons 6 personnes.
2.4. Généralisation. Analyse des données empiriques
L'enquête a porté sur 30 personnes (12 hommes et 18 femmes). Ce sont des jeunes entre 15 et 21 ans. La plupart d'entre eux sont des étudiants universitaires. D'après l'enquête, on constate que seulement 21% se considèrent croyants, et un peu moins de la moitié des répondants croient plutôt que non. Les athées étaient plus susceptibles d'être des hommes de moins de 20 ans. La plupart des répondants professent l'orthodoxie. Sur la question de la priorité de l'orthodoxie sur les autres religions en Russie, il n'y avait pas de consensus d'environ un tiers des personnes interrogées pour la priorité de l'orthodoxie sur les autres religions - 36,36%, soit environ le même nombre de personnes pour une autre religion. La plupart des répondants des objets de culte ont des icônes. Mais la littérature religieuse n'est lue que par les filles - 6,06% des répondants. Dans un moment difficile, seuls 6,06% se tourneraient vers un prêtre pour obtenir de l'aide. Près de la moitié (42,42%) aimeraient suivre un cours d'histoire des religions. De plus, les répondants de plus de 19 ans ont répondu positivement à cette question. Ils ont également indiqué qu'ils préféraient que quelqu'un du clergé dirige ce cours. L'analyse de la religiosité de la jeunesse russe permet de constater un phénomène nouveau, par rapport aux données de la période pré-perestroïka. Il s'agit de dépasser les stéréotypes négatifs qui existaient auparavant chez les jeunes, implantés par les programmes scolaires et l'éducation athée en général (tels que « la religion entrave le développement de la science », « la religion est le lot des vieilles femmes », etc.) . La religiosité de la jeunesse moderne est déterminée par la religiosité de la famille - et cela ne peut être contesté. Prières des parents, littérature religieuse et objets de culte dans la maison, traditions - tout cela évoque une attitude envers la religion chez une personne dès l'enfance.
Dans le monde moderne, lorsque la science et la technologie sont en avance, toute spiritualité s'efface. Et cela engendre d'autres problèmes : les jeunes grandissent tôt, l'autorité parentale diminue, les traditions deviennent obsolètes, la confiance dans la religion diminue, les jeunes se tournent de moins en moins vers leurs parents pour obtenir de l'aide et du soutien, le manque de un cours d'histoire de la religion dans les établissements d'enseignement ne leur permet pas d'acquérir des connaissances supplémentaires sur la foi, la jeunesse moderne est de plus en plus engagée dans des affaires personnelles, aller à l'église n'est pas inclus dans leurs plans, toutes sortes de théories scientifiques sur l'origine de l'homme prouver de toutes les manières possibles que l'homme ne vient pas de Dieu, réfutant ainsi la fiabilité de la Bible.
Le monde moderne peut être qualifié de période "difficile" pour la religion. Mais les résultats de l'enquête montrent qu'il y a encore des gens pour qui la foi est la partie la plus importante de leur vie.
Conclusion
Le problème de la religiosité et de la spiritualité est un problème très important de notre siècle - l'ère de l'information. Quand de plus en plus de gens placent le matériel au-dessus du spirituel. L'athéisme n'est pas seulement une décision personnelle d'une personne. C'est en quelque sorte le résultat de l'éducation, et du soutien moral et psychologique d'un adolescent, et de son environnement, et des relations avec ses pairs... Et qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui influence moins? Nous ne pouvons pas répondre sans ambiguïté. Le thème de la religion n'est donc pas complètement étudié, car c'est l'un des sujets les plus intimes. Tout le monde ne pourra pas raconter ses expériences.
La grande majorité des croyants chrétiens russes parmi les jeunes ne fréquentent pas régulièrement les églises, ne deviennent pas des paroissiens permanents en raison de facteurs généralement dus à la présence d'une crise organisationnelle interne profonde dans l'église. Les divergences de vues entre les dirigeants d'église et les croyants eux-mêmes sur les facteurs qui déterminent leur motivation à participer aux activités de l'église sont évidentes. Ces écarts se situent entre les croyants qui ne satisfont pas leurs besoins spirituels tout en étant activement impliqués dans la vie de l'église, et l'église elle-même, représentée par les dirigeants. Ceux qui ont une vision du problème qui ne coïncide pas avec la position des croyants, qui est une manifestation de la crise existante. Les gens ont besoin de plus d'ouverture, de flexibilité de l'église, de sa plus grande tolérance envers eux. L'église devrait être moins superficielle et plus morale qu'elle ne l'est actuellement.
Le facteur suivant est que l'ère de l'information fait des ravages. La jeunesse cherche avec la rapidité d'obtention du résultat final. La foi a une moindre priorité pour eux que, par exemple, l'enseignement supérieur et une carrière.
Aussi, n'oublions pas que dans le rythme difficile de la vie moderne, certains jeunes hommes et femmes n'ont tout simplement pas le temps de réfléchir à quelle religion est la plus proche d'eux ? Vaut-il la peine de choisir la foi pour vous-même ?
Bien que suggère plutôt l'idée qu'ils ne veulent pas y penser. Après tout, la foi n'apporte aucun avantage matériel. Et ici une autre question, plus terrible, se pose sur le manque de spiritualité de la nouvelle génération. La génération qui a remplacé le système soviétique.
Tous ces facteurs indiquent le faible intérêt des jeunes pour la sphère des religions. Mais les statistiques sont au rendez-vous. Cela signifie que dans le cœur du peuple russe, il y a encore de la place pour la foi.
À la suite des travaux effectués, nous retenons ce qui suit :
1. L'orthodoxie est toujours la religion numéro un en Russie. Malgré toutes les difficultés et les problèmes, les gens perpétuent les traditions, éduquent une génération croyante. Ce n'est pas un hasard si sur 33 jeunes femmes et jeunes hommes interrogés, seuls trois ont répondu qu'ils étaient athées.
2. Après avoir «transféré» l'interdiction de la religion en URSS, et même pendant la révolution scientifique et technologique et à notre époque de l'information, l'orthodoxie est en hausse. Malheureusement, les jeunes cessent de lire la littérature religieuse, vont moins souvent à l'église… Pour cela, les traditions sont ravivées et transmises de génération en génération. L'orthodoxie change un peu avec le temps, mais son essence reste la même.
Le thème de la "religion" est l'un des principaux thèmes de la vie humaine, car la religion est la foi. C'est quelque chose qui a aidé, donné de la force et été un soutien pour toute l'humanité depuis l'apparition de la vie sur Terre. La foi a toujours inspiré les gens à de grandes actions. À notre époque de haute technologie, surtout chez les jeunes, la foi passe au second plan. Et c'est un chemin sûr vers la spiritualité. C'est pourquoi l'étude de l'attitude de la jeunesse moderne envers la religion est particulièrement importante. La foi est un côté intime de la vie d'une personne, tout le monde ne «déposera» pas son âme devant un sociologue. De là, l'étude de la religion à tout moment était incomplète et insuffisante. Notre tâche, en tant que chercheurs, est de pénétrer dans l'essence, d'aider une personne à s'ouvrir et peut-être à comprendre quelque chose par elle-même.
Graphiques. Les tables.
|
Nom de la fonctionnalité |
Nombre de répondants |
|
|
Plutôt oui que non |
||
|
Plus probablement non que oui |
||
|
Difficile de répondre |






Liste bibliographique
1. Garaja V. I. Sociologie de la religion. 1995. S. 105-106.
2. Golovaty N.F. Sociologie de la jeunesse: un cours de conférences. 1999, p.59.
3. Garaja V. I. Sociologie de la religion. 1995, p.36.
4. Garaja V. I. Sociologie de la religion. 1995. S. 110-114.
5. La Russie au tournant du siècle. M. : Institut indépendant russe des problèmes sociaux et nationaux, 2000, pp. 145-146.
6. La Russie au tournant du siècle. Moscou : Institut indépendant russe pour les problèmes sociaux et nationaux, 2000, p. 147.
7. Bezrukova O. N. Sociologie de la jeunesse. Aide pédagogique. 2004. P.31.
8. Comment mener une étude sociologique : Pour aider ideol. atout / Éd. M. K. Gorshkova, F.E. Sheregi. M., 1990. S. 67.
Application
Cher collègue!
Nous vous proposons de participer à une enquête sociologique universitaire pour étudier la religiosité de la jeunesse d'aujourd'hui. Les résultats de l'enquête sont nécessaires pour connaître le niveau de religiosité des jeunes, pour déterminer la nécessité d'introduire un cours d'études religieuses dans les établissements d'enseignement.
La plupart des questions sont accompagnées d'une liste de réponses possibles. Après avoir choisi l'option de réponse qui vous convient, encerclez son numéro de série. S'il n'y a pas d'options de réponse, écrivez votre propre réponse. Lisez attentivement le libellé des questions et les explications qui leur sont données ! La valeur de l'étude dépendra de votre attention et de la sincérité de vos réponses.
L'enquête est anonyme. Toutes les données de l'enquête ne seront utilisées que sous forme agrégée. Votre opinion personnelle ne sera pas divulguée.
Merci pour votre aimable aide avec l'enquête!
1) Vous considérez-vous comme croyant ?
2. Plus probablement oui que non
3. Plutôt non que oui
5. Difficile de répondre
2) Quelle est votre religion ?
1. Orthodoxie
2. Catholicisme
3. Protestantisme
5. Autre ________________________________________________
3) L'orthodoxie dans notre pays devrait-elle avoir la priorité sur les autres religions ?
3. Peut-être
4) Avez-vous des objets religieux à la maison (quel genre) ?
2. Crucifix
3. Images
4. Autre _______________________________________________
5) Achetez-vous et lisez-vous de la littérature religieuse ?
6) Si vous êtes athée, alors la principale source de votre foi est :
2. Signes
3. Médiums
4. Autre _______________________________________________
7) Vers qui vous tourneriez-vous pour obtenir de l'aide dans les moments difficiles ?
1. Aux parents
2. Aux amis
3. À un psychologue
4. Au prêtre
8) Comment réagiriez-vous à l'introduction d'un cours d'histoire des religions dans votre établissement d'enseignement ?
1. Positif
2. Négatif
3. Difficile de répondre
9) Si vous réagissiez positivement, qui préféreriez-vous comme enseignant ?
1. Personne spirituelle
2. Mondain
Enfin, veuillez fournir quelques informations sur vous-même.
10) Quel est votre sexe ?
1. Homme
2. Femme
11) Quel âge as-tu ?
12) Quelle est votre formation ?
1. secondaire inachevé
2. moyenne
3. secondaire spécial
4. supérieur
13) Lieu de formation ?
Instruction au questionnaire
Cher arpenteur !
Vous participez à l'étude panrusse "Orientations sur les valeurs de la jeunesse étudiante russe : aspects socio-politiques et éducatifs" organisé sous les auspices du Ministère de l'éducation et des sciences de la Fédération de Russie. Les résultats de l'étude amélioreront l'efficacité et la coordination des actions des autorités exécutives fédérales, régionales et locales, des organisations éducatives et des institutions dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la politique de la jeunesse.
je. Préparation de l'enquête
1. Tout d'abord, lisez attentivement le questionnaire et comprenez par vous-même la technique de réponse (réponses) à chaque question.
2. Préparer le nombre requis de questionnaires selon la liste du groupe sélectionné pour l'enquête ( hors étudiants étrangers qui ne font pas l'objet d'un interrogatoire), deux ou trois stylos à plume et plusieurs feuilles standard vierges. Des feuilles vierges peuvent être nécessaires si l'un des répondants a du mal à répondre brièvement aux questions et souhaite y répondre en détail.
3. Vérifiez l'emplacement de l'enquête. Il devrait y avoir un nombre suffisant de postes de travail dans la pièce pour que les personnes interrogées ne se gênent pas pendant le travail.
4. Préparez-vous à un travail responsable et à une attitude positive juste avant de mener l'enquête.
II. Mener une enquête
1. Commencez la procédure d'enquête par un discours d'introduction, au cours duquel essayez de convaincre les répondants, créez une atmosphère détendue mais de travail dans le public. N'oubliez pas que vous devriez recevoir non seulement des réponses aux questions, mais réponses les plus franches.
2. Dans vos remarques liminaires, présentez-vous aux répondants, nommez le sujet de l'étude, expliquez brièvement son objectif et son importance pour l'amélioration de la politique de la jeunesse et de l'éducation en Russie. Privilégier l'anonymat de l'enquête. Si nécessaire, expliquez le principe aléatoire de l'échantillonnage.
3. Distribuez les questionnaires. Expliquer (démontrer) la technique de remplissage du questionnaire à l'aide de l'exemple de questions de différents types : fermées (n°3,4,5, etc.), semi-fermées (n°1,21,26, etc.), ouvert (n° 8, 9, 15) et autres), questions sous forme de tableau (n° 2, 6, 11, etc.). Demandez aux répondants d'encercler leurs choix de réponses. Indiquez ce qui suit aux répondants :
les réponses doivent être données assez rapidement, sans réfléchir longtemps;
il faut répondre à toutes les questions ; une exception ne peut être que les questions commençant par le mot "si" (n° 7, 11, 18, etc.) dans le cas d'une réponse appropriée à la question précédente ;
les réponses vagues (« difficile de répondre », etc.) ne doivent être données qu'en dernier recours ;
lorsque vous remplissez des questions semi-fermées, les lignes « autre » doivent être écrites de manière détaillée et lisible ;
les mots soulignés dans le libellé des questions et leurs explications (n° 17, 19, 27, etc.) sont très importants et nécessitent une stricte adhésion ;
toutes les questions données sous la forme habituelle (une question suivie d'une liste de réponses possibles) ne nécessitent qu'une seule réponse ;
dans les tableaux, une seule position dans chaque ligne doit être marquée, à l'exception des tableaux avec une explication donnée en italique entre parenthèses : marquer deux positions dans chaque ligne du tableau (n° 17, 19, 27, 29) ;
les réponses à la question n° 40 doivent être marquées (numérotées) dans des rectangles vides à leur droite ;
les colonnes vides dans les questions sur les parents (nos 53, 54) devraient signifier leur absence ou leur manque d'informations à leur sujet.
4. Si l'un des répondants refuse de remplir le questionnaire, n'insistez pas sur sa participation à l'enquête, mais son contact avec d'autres répondants pendant le travail n'est pas souhaitable.
5. Assurez-vous qu'en remplissant les questionnaires, les répondants ne communiquent pas et ne discutent pas entre eux des questions et des réponses possibles. Si les répondants viennent vous voir avec des questions qui ne sont pas liées à la technique de remplissage du questionnaire, promettez-leur de discuter et de discuter des problèmes soulevés après la fin du travail de groupe. Écrire tout questions que vous recevez.
6. Lors de la soumission des questionnaires vérifier l'exactitude de leur remplissage, en commençant le contrôle par le "passeport" (dernières questions). Chercher à éliminer les lacunes existantes.
7. Immédiatement après l'entretien, rédigez un court rapport reflétant les difficultés que vous avez rencontrées, ainsi que contenant les questions qui vous sont posées par les répondants. Le rapport doit être joint aux questionnaires remplis.
Moderne jeunesse en Russie Travail scientifique >> Philosophie
Provoquant l'apathie, l'indifférence; l'introduction de destructeurs religieux sectes et enseignements, etc. ... sorte de national, culturel, religieux, infraction territoriale. Decay..., №8,2006 V.E. Semenov Value Orientations contemporain jeunesse// Sotsis, n° 4, 2007 ; Avec. 37 ...
Stéréotypes sociaux de comportement contemporain jeunesse
Thèse >> PsychologieDéfinir des normes morales, former des politiques, religieux et concepts de vision du monde. Les stéréotypes comportementaux très ... ont révélé la présence de stéréotypes sociaux dans la perception contemporain jeunesse caractéristiques inhérentes à certains types d'activités...
Amélioration des orientations familiales contemporain jeunesse
Résumé >> Etat et Droit... contemporain jeunesse 3.1. Les grandes tendances de l'amélioration des orientations familiales contemporain jeunesse Orientation familiale bien-être jeunesse sur le contemporain... tous 4 6 3 de profondeur religieux 1 1 1 Tableau 2.1. Opinion jeunesse sur les valeurs dominantes de la vie, en ...
Établissement d'enseignement non étatique
Enseignement professionnel supérieur
Institut d'économie et de droit de Tcheliabinsk. M.V. Ladoshina
Faculté d'entrepreneuriat et de droit
Département des relations publiques
Recherche sociologique
LA RELIGION DANS LA VIE DE LA JEUNESSE MODERNE À TCHELYABINSK
Interprété par l'étudiant gr.
Conseiller scientifique:
Candidat en sciences, professeur agrégé
Date de soutenance "__" _____ 201_.
Noter__________ __________
________________ ___________
(signature du gérant)
Tcheliabinsk
2011
Table des matières
Volet méthodologique………………………………………………………3
Volet Méthodologique………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….sept
Analyse des résultats de la recherche……………… …………………………..8
Références………………………………………………………………11
- Section méthodologique
On observe ce phénomène aujourd'hui en Russie. Il y a une crise spirituelle et morale dans notre pays. Le problème du renouveau des valeurs spirituelles et de leur assimilation par la jeune génération est débattu au niveau étatique, social, ainsi que par les médias et la communauté pédagogique. On observe des exemples de « conversion » religieuse massive dans des groupes de population d'âges et de professions différents, mais elle est particulièrement perceptible chez les jeunes. C'est compréhensible, puisque la formation des orientations se déroule en elle. Pour elle, les conditions d'entrée dans la vie ont radicalement changé, les possibilités d'un développement social et civil à part entière sont considérablement limitées, elle a perdu les orientations sociales, morales et idéologiques. Le rôle des institutions de socialisation des jeunes a été considérablement affaibli, qu'il s'agisse de la famille, de l'école, du système d'enseignement professionnel, des organisations sociopolitiques, des mouvements, des médias et des communications. L'église occupe activement sa place dans cette rangée, introduisant quelque chose de nouveau dans le processus compliqué de la formation sociale des jeunes hommes et femmes. Le processus de formation de la spiritualité des jeunes est inextricablement lié aux valeurs religieuses, en particulier aux valeurs de l'orthodoxie.
La religion a toujours occupé une place particulière dans l'histoire de la Russie, mais le rôle qu'elle joue dans la vie de la jeunesse moderne n'a pas été suffisamment étudié.
objet de notre étude est la jeunesse de Tcheliabinsk (garçons et filles de 14 à 30 ans)
Matière- la religion dans la vie de la jeunesse moderne
Cible- étude de la religiosité de la jeunesse moderne à Tcheliabinsk
Pour atteindre cet objectif, nous avons défini les éléments suivants Tâches:
- étudier la religiosité des jeunes en général, le pourcentage de croyants ;
déterminer l'importance de la foi et des valeurs religieuses pour la personnalité d'un jeune;
étudier les besoins des jeunes dans l'Église orthodoxe; dans la visite, en communion avec le clergé, dans l'accomplissement des rites
- la religiosité de la jeunesse de Tcheliabinsk est au plus bas ;
les jeunes ne sont pas attirés par l'Église orthodoxe et ses valeurs ;
les jeunes ne manifestent pas d'intérêt pour l'accomplissement des rites orthodoxes (c'est fatiguant, il n'y a pas de temps, d'autres intérêts)
- Analyse système de l'objet
Le concept de "jeunesse" a connu une longue évolution. À différentes périodes de l'histoire dans différents pays, il était compris comme différents groupes de la société. Par exemple, Pythagore a divisé la vie d'une personne selon les saisons: printemps - de la naissance à 20 ans, été 20-40 - c'est la jeunesse. Jean-Jacques Rousseau a divisé l'âge de la jeunesse en 5 périodes : de la naissance à un an, d'un an à 12 ans, 12-15, 15-20, 20-25. Maintenant, il y a une tendance à augmenter l'âge de la jeunesse. Cela est dû au fait que la période d'études s'est maintenant allongée et que les jeunes entrent plus tard dans une vie indépendante. En Fédération de Russie, il est d'usage de se référer à la catégorie des jeunes de 14 à 30 ans inclus (au Luxembourg, la limite supérieure est de 31 g, en France - 25).
Dans une société traditionnelle, une personne directement de l'enfance est entrée dans l'âge adulte, sans aucune étape intermédiaire. Il y avait des rites spéciaux de passage à l'âge adulte (initiation). À Kievan Rus, une personne de 10 ans était considérée comme une personne morale et pouvait formellement occuper certains ponts de l'État, et les princes de 12 ans, qui avaient terminé leurs études à ce moment-là, étaient soumis à un rite d'initiation à la soldats avec l'attribution officielle du statut - "Guerrier-Guerrier de la Druzhina".
La jeunesse en tant que groupe social spécial n'a commencé à être perçue qu'avec le passage à la phase industrielle de développement. Pourquoi?
1) L'approfondissement de la division du travail provoqué par la révolution industrielle a séparé la famille du processus de production et de gestion des processus sociaux. Cela rendait l'éducation familiale insuffisante pour maîtriser de nombreux rôles sociaux.
2) La complication de la technologie, la spécialisation croissante requise pour maîtriser les connaissances et les compétences nécessaires pour allonger la durée de l'enseignement général.
3) La croissance de la mobilité des personnes, la complication de la vie sociale, l'accélération du rythme des changements sociaux ont conduit au fait que le mode de vie des générations plus âgées et plus jeunes a commencé à différer considérablement; une sous-culture de jeunes a émergé.
Sur le chemin de la croissance, il y a deux étapes : l'adolescence et la jeunesse. Cependant, les limites d'âge de chacune des étapes sont assez floues. Les jeunes en tant que groupe social couvrent les personnes âgées de 16 à 25 ans. L'adolescence est le plus souvent considérée comme l'âge de 11 à 15 ans et la jeunesse précoce - de 16 à 18 ans, mais dans certains cas, la limite supérieure est de 20 ans. De la psychologie occidentale est venu le terme adolescent, couvrant les jeunes de 13 à 19 ans, c'est-à-dire à l'âge indiqué par des chiffres se terminant par "teen".
L'achèvement de l'adolescence est associé à: l'obtention du diplôme, le mariage, l'accouchement, le début d'une carrière professionnelle, l'indépendance économique et sociale, l'acquisition des droits politiques, la formation claire d'un système de valeurs.
La jeunesse est une génération de personnes passant par le stade de la socialisation, assimilant des qualités éducatives, professionnelles et civiques et préparées par la société à remplir des rôles d'adultes.
- Interprétation et opérationnalisation des concepts
Religiosité- une caractéristique de la conscience et du comportement des individus, de leurs groupes et communautés qui croient au surnaturel et le vénèrent. Religiosité de la jeunesse- le degré de familiarisation des jeunes avec les valeurs et les systèmes religieux. Une certaine forme ou degré de conscience religieuse, d'expérience et de comportement des jeunes.
La religiosité est déterminée par la fréquence à laquelle les gens vont à l'église, célèbrent les fêtes orthodoxes et lisent de la littérature religieuse. Ont-ils des objets religieux dans leur appartement, fréquentent-ils une école paroissiale, etc.
confession- la religion. L'identification de soi avec des croyants d'une certaine confession est la confession d'une certaine religion.
Église- 1. Le type d'organisation religieuse, une institution sociale qui exerce des activités religieuses, tout en utilisant un régime autoritaire centralisé et hiérarchique, des dispositions établies de croyances religieuses, des systèmes de normes, de morale et de droit canonique. 2. Synonyme de religion, dénomination, mouvement religieux 3. Dans le christianisme, édifice religieux, salle de culte.
- Section méthodique
Le plan de recherche stratégique est descriptif.
La population générale est la jeunesse de la ville de Tcheliabinsk âgée de 14 à 30 ans.
La méthode d'échantillonnage est une "boule de neige". Carl'avantage de cet échantillon est qu'il augmente significativement la probabilité de retrouver la caractéristique étudiée dans la population. Il a également une variance d'échantillon relativement faible et un faible coût.
Plan d'étude
| Étape de travail | Calendrier de mise en œuvre | Responsable |
| Analyse de la littérature | 39.04.11 – 30.04.11 | Volkova Svetlana |
| Développement de programme | 01.05.11 – 02.05.11 | Volkova Svetlana |
| Élaboration de questionnaires | 02.05.11 – 04.05.11 | Volkova Svetlana |
| Études pilotes | 04. 05. 11 – 05. 05. 11 | Volkova Svetlana |
| Enquête de terrain | 06. 05. 11 – 09 .05.11 | Volkova Svetlana |
| Préparation des données primaires pour le traitement | 10. 05. 11 | Volkova Svetlana |
| Traitement, analyse et interprétation des données | 11. 05. 11 | Volkova Svetlana |
| Présentation des résultats, préparation du rapport | 12. 05. 11 | Volkova Svetlana |
- Analyse des résultats de l'étude
- Signaler
81,25% des répondants ont un enseignement supérieur incomplet, 6,25% ont un enseignement secondaire général, 6,25% du nombre total des enquêtés ont un enseignement secondaire professionnel et 6,25% ont un enseignement supérieur.
56% du nombre total de répondants se considèrent comme croyants. 31,5% des répondants ne croient pas en Dieu, 12,5% ont du mal à répondre. Les répondants expliquent leur foi en Dieu par le fait que Dieu les aide, il faut le croire, puisque Dieu est amour et protection, cela a été le cas de génération en génération. Les jeunes qui ne se considèrent pas comme croyants l'ont expliqué en disant que l'existence de Dieu est indémontrable, c'est une image inventée, donc il ne sert à rien de croire en lui. 43% des jeunes ne pouvaient pas nommer la raison pour laquelle ils croient ou ne croient pas en l'existence de Dieu.
81,25% des répondants se considèrent orthodoxes, 12,5 professent l'islam et 6,25% s'identifient comme athées.
56,25% des répondants affirment qu'ils ne sont allés à l'église que quelques fois dans leur vie, 18,75% des répondants ne sont jamais allés à l'église, le même pourcentage va à l'église 2 à 3 fois par an et seulement 6,25% vont à l'église plusieurs fois .une fois par mois.
25 % des répondants célèbrent les fêtes orthodoxes, le même nombre ne célèbrent pas du tout et 50 % célèbrent, mais pas toujours.
La majorité, 75% des répondants, ont accompli à un moment donné le sacrement du baptême, 6,25% d'entre eux ont également confessé et 6,25% ont reçu la communion.
Seuls 6,25% de ceux qui n'ont pas été baptisés aimeraient accomplir le rite du baptême, 56,25% des enquêtés aimeraient se marier (il est curieux que tous les 56,6% des filles), 18,75% aimeraient communier.
81,25% sont positifs sur le sacrement de baptême des enfants dans la jeunesse (même ceux qui ne croient pas en Dieu), 6,25% sont négatifs, 12,25% ont du mal à répondre.
68% des répondants ont des icônes orthodoxes à la maison.
100% des jeunes enquêtés n'ont pas fréquenté et ne fréquentent pas une école paroissiale.
18,75% des jeunes lisent de la littérature religieuse. Le reste n'a jamais lu.
100% des répondants ne fréquentent aucune autre église que l'orthodoxe.
12,5% des répondants estiment que l'Église orthodoxe doit être réformée, à savoir démocratisée. 25% des répondants disent que l'église devrait être laissée telle quelle. Les autres ont eu du mal à répondre.
68% des jeunes de Tcheliabinsk en situation difficile se tourneraient vers leurs parents pour obtenir de l'aide, 19% vers des amis, seulement 6,25% vers un psychologue et le même nombre vers un prêtre.
Ainsi, nous avons étudié la religiosité de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons déterminé le pourcentage de jeunes croyants, également déterminé l'importance de la foi et des valeurs religieuses pour la personnalité d'un jeune, étudié les besoins des jeunes dans l'Église orthodoxe, en visitant, en communiquant avec le clergé, en accomplissant des rituels .
etc.................